De passage au festival Lire en Poche, où il intervenait sur un débat « Des vies en noir » pour lequel il fut parfait, nous en avons profité pour revenir avec Nicolas Mathieu sur Aux Animaux la guerre son premier roman qui nous fait tant attendre le second…
Question tarte à la crème, comment est né ce livre ?
En 2008, j’étais rédacteur dans une agence de reporting. Ça consistait à faire le greffier dans des réunions, des Comité d’Entreprise le plus souvent. C’est ainsi que je me suis retrouvé à suivre des plans sociaux au moment de la crise des subprimes. Je rédigeais les procès-verbaux des réunions de négociations où s’opposaient représentants du personnel et directions. A ce moment-là, j’avais vraiment le sentiment d’assister à la crise en direct, de voir des pans entiers de l’industrie se casser la gueule sous mes yeux. Je me suis dit, comment raconter ça, la fin d’un monde vue de l’intérieur ? Comme j’avais écrit beaucoup, et pour 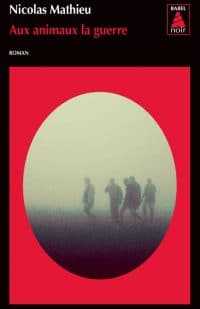 l’essentiel des trucs chiants et narcissiques, je me suis dit que le roman noir serait un bon moyen de traiter ce sujet en contournant ma mauvaise pente.
l’essentiel des trucs chiants et narcissiques, je me suis dit que le roman noir serait un bon moyen de traiter ce sujet en contournant ma mauvaise pente.
Le quatrième de couverture résume bien votre livre « Aux animaux la guerre, c’est le roman noir du déclassement, des petits Blancs qui savent que leurs mômes ne feront pas mieux et qui vomissent d’un même mouvement les patrons, les Arabes, les riches, les assistés, la terre entière. C’est l’histoire d’un monde qui finit. » Vous pouvez développer ?
Mes parents ont grandi et commencé à bosser durant les Trente Glorieuses. Ils m’ont transmis l’idée d’un progrès continu, d’un sort collectif qui ne pouvait qu’aller en s’améliorant, d’une société qui tenait ses promesses pourvu qu’on se donne du mal. Après la chute du mur, le terme de mondialisation s’est imposée, la désindustrialisation poursuivie, on a compris que la fête était finie. Aujourd’hui, dans le monde d’où je viens (chez les petits blancs de la France périphérique pour la faire courte) on ne se fait plus d’illusions. On sait que le meilleur est derrière. Les solutions politiques qu’on y envisage ressemblent d’ailleurs souvent à des machines à remonter le temps. En plus, j’ai grandi en Lorraine, une terre de Fer et de Charbon, de gloires ouvrières englouties. J’ai voulu dire ça, la fin d’un monde.
Comment avez-vous travaillé votre portrait des ouvriers ?
Quand je bossais comme rédacteur, je me suis retrouvé dans des usines dans le Nord de la France. Il faut imaginer le truc. Je me pointais très tôt le matin, avec ma tête de bobo et mon petit ordi. Je me retrouvais face à des mecs en bleu de travail, de grosses pognes et des chaussures de sécu, des braves types qui allaient peut-être perdre leur job. Et curieusement, je me suis vraiment plu en leur compagnie. Moi qui était monté à Paris pour écrire (selon un mouvement centrifuge démodé depuis Balzac, mais qui se poursuit néanmoins), je retrouvais auprès d’eux des allures, des paroles, des corps qui m’étaient familiers. Forcément, ces ouvriers, c’était mon père, mes oncles, leurs copains. Donc je me suis contenté de parler de ce que je connaissais, des gens qui m’avaient vu grandir.

On y voit cette usine, qui broie les gens, mais qui se battent légitimement pour conserver leur métier quitte à « tricoter leur mythologie » et oublier « Des vies brisées par le boulot, des corps rognés, tordus, des existences écourtées, des horizons minuscules »…
Oui, j’ai été très frappé par l’attachement des gens à leurs usines. C’est le drame de la désindustrialisation. Les types sont certes souvent exploités, ou au moins usés par le travail, mais ils bénéficient de l’héritage des lutte sociales menées avant eux, ils ont leurs potes, leurs habitudes, toute une vie et des familles organisées autour de ce cœur ingrat et brutal : l’usine.
Le roman noir a cette vertu : il vous appâte avec des filles, des flingues, des poursuites, et fait passer en contrebande tout le reste : de la socio, de la métaphysique, de l’histoire, un peu de poésie aussi.
Mais comme vous le disiez, en citant Manchette, un roman sans jugement…
J’avais aussi été marqué par une phrase de Proust : « Au début, Victor Hugo pensait, au lieu de faire comme la nature, donner à penser. »
Si on veut sortir des facilités de la communication, des réflexes du robinet journalistique, c’est ça qu’il faut faire, essayer de restituer des mondes, dans leur complexité, leurs ambivalences, être un témoin qui sent et rend compte, pas un procureur qui instruit des procès ou cherche à distinguer des camps.
Et toujours sur Manchette, le rapport du noir et du social.
Clairement, c’est en lisant ses chroniques que je me suis dit : le roman noir, c’est l’outil parfait pour faire ce que je veux faire. Écrire un roman populaire sur le peuple. Décrire un état du monde à un instant T sans faire l’économie du plaisir, d’une certaine dose de divertissement. Le roman noir a cette vertu : il vous appâte avec des filles, des flingues, des poursuites, et fait passer en contrebande tout le reste : de la socio, de la métaphysique, de l’histoire, un peu de poésie aussi.
Et parlant de Manchette vous remontez à Hammett et au béhaviorisme, pouvez-vous nous en parler ainsi que de votre technique d’écriture ?
J’ai coutume de dire : « Longtemps j’ai écrit des trucs chiants. » Comme je disais au début, des trucs narcissiques, complaisants, sans histoire et avec plein de psychologie. Le behaviorisme est un formidable antidote. Même si je ne tiens pas complètement le pari comportementaliste et que je m’aventure parfois dans l’esprit des personnages, ce parti pris m’a au moins permis de prendre du recul par rapport à mon nombril, de visualiser les choses, de produire de l’action. Au cinéma comme dans les romans behavioristes, on commence par dire : ACTION.
Quant à la technique, je ne sais pas trop. Les choses se déplient en écrivant. Je n’aime pas écrire. J’aime avoir écrit ou réécrire. Le moment où il faut arracher de la matière au vide est vraiment pénible. Je peine, je manque d’idées, d’imagination, de finesse. Et puis quand j’ai du texte et que je vais pouvoir commencer à bosser dessus, je respire un peu mieux.

Vous avez aussi parlé de l’intérêt d’étudier les points de bascule et cité Jean Renoir « Tout le monde a ses raisons »…
Je crois fermement à la morale du point de vue, qui n’est pas du tout une espèce de catéchisme. C’est simplement se dire qu’en tant qu’auteur, on utilise un outil absolument formidable : l’empathie. Qu’est-ce qu’on va en faire ? A quoi ça sert ? Faire en sorte que les gens s’identifient à des héros bigger than life et se consolent ainsi de leurs existences minuscules ? Pourquoi pas ? Faire éprouver la crainte des victimes à des lecteurs qui doivent tourner les pages le plus vite possible pour savoir s’ils vont s’en sortir ? Oui, peut-être bien. Mais ça sert surtout à se mettre dans les baskets de l’autre, faire éprouver d’autres vies que la sienne. Comprendre que le monde n’est jamais univoque, que chacun est à la fois libre et conditionné, que les forces qui s’exercent sur nous sont inexorables, que les circonstances atténuantes sont presque toujours la règle.
Dans ce roman, on suit, entre autres, une inspectrice du travail, n’est-ce pas aussi un portrait d’un métier en voie de disparition ?
Je n’irais pas jusque-là. C’est un métier sinistré. De plus en plus de dossiers, pas assez d’effectifs, et puis au fond, un combat complètement déséquilibré. Que peuvent les inspecteurs face à des PME au bord du gouffre, des multinationales toute puissantes, des salariés qui craignent de se retrouver sur le carreau, des managers qui doivent produire des résultats jusqu’à ce que mort s’ensuive, etc.
Nous attendons avec impatience votre second roman mais visiblement vous êtes sur d’autres projets…
Je bosse depuis presque un an et demi sur l’adaptation du roman pour la TV. Ce sera une série de 6 épisodes pour France 3, réalisé par Alain Tasma. Tournage en 2017. Si tout va bien.
Des choses à rajouter ?
Good night and good luck.
Pour aller plus loin
Nicolas Mathieu chez Actes Sud
