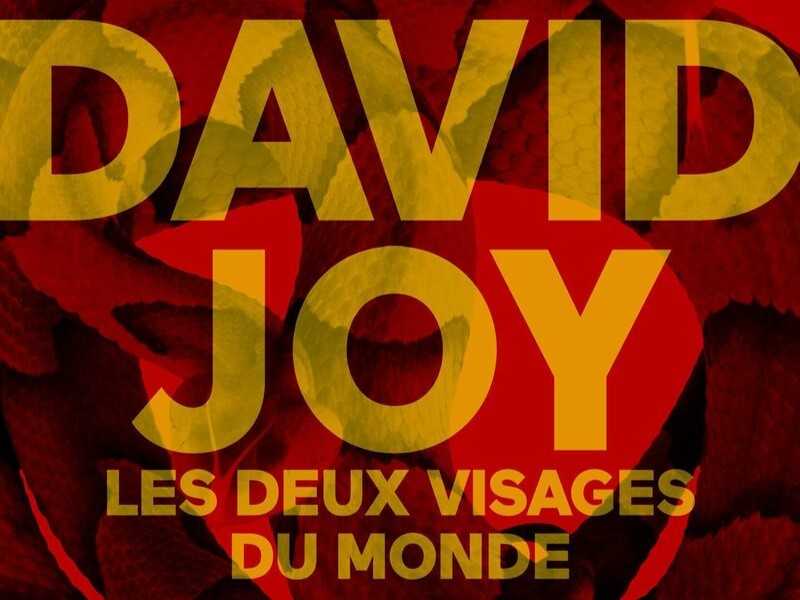Nous avons profité du festival America 2024 pour rencontrer David Joy dont le dernier roman, Les Deux Visages du monde, venait de paraître chez Sonatine.
À l’arrivée, nous avons peu parlé des livres en eux-mêmes mais plus de sa terre natale et de ses bouleversements, de son attachement à celle-ci et au pouvoir de la littérature, car l’empathie et la sympathie de David Joy ont fait que la discussion est venue très naturellement.
Les Appalaches, lieu des romans de David Joy
Milieu Hostile : Pour commencer, je voulais parler du lieu. C’est l’écrivain sarde Giorgio Todde qui le premier m’a expliqué que la terre façonnait les hommes et donc les histoires. Et la première fois que j’avais interrogé Ron Rash, il m’avait dit « Je suis tout à fait d’accord. Ma formule fondamentale est “le paysage est le destin”, c’est-à-dire que la personne que vous êtes est générée par l’endroit où vous vivez ». Qu’en pensez-vous ?
David Joy : Effectivement, Ron Rash a dit que le paysage c’est comme le destin, c’est une question de destin. Et je pense que c’est vrai. Je pense que grandir et vivre dans l’endroit d’où je viens avec un tel paysage, fait que c’est impossible d’ignorer ce paysage, parce qu’on est entouré par ce paysage, c’est immense, et on ne peut pas s’empêcher d’en ressentir les effets. Je pense que c’est comme grandir dans les Pyrénées par exemple, on ne peut pas ne pas voir un tel paysage et ne pas en subir les effets. Les personnes et les paysages sont inséparables. Ce sont deux choses qui sont reliées, nouées ensemble. Et il y a des noms qui sont reliés aux endroits et aux lieux. Ce sont comme deux choses qu’on ne peut pas séparer. La première question qu’on demande chez moi c’est comment tu t’appelles ? Mais ce qu’on veut dire en fait c’est quel est ton nom de famille ? Parce que c’est comme ça que les gens vous situent. Et dès que je connais ton nom de famille, je connais en fait ta famille, l’endroit d’où tu viens, de génération en génération.
Comme on le voit dans tous vos romans, et magnifiquement dans le dernier, il y ce poids de la filiation, des générations, illustré par cette phrase : « Au bout du compte, c’est toujours le sang qui parle. »
Vous savez, les gens me disent souvent que j’écris sur les Appalaches. En fait, non, je n’écris pas sur cette région. C’est une région immense, plus grande que la Californie. Donc je n’écris pas sur la région dans son ensemble, je ne la connais pas dans son ensemble, mais je connais très bien l’endroit d’où je viens, de façon intime, de façon très intime, même. Et toutes mes histoires se passent dans cet endroit confiné. C’est comme avoir une conversation entre mes différentes histoires, on peut dire qu’il y a comme un échange entre elles. De la même façon que Faulkner situe ces histoires dans le Mississippi. Quand on vit dans les montagnes, il y a deux façons de ressentir les émotions qui découlent du fait d’être entouré par ce paysage. Mes personnages luttent constamment entre ces deux émotions. La première, c’est celle de se sentir coincé, confiné, comme en prison, ou emmuré. Et la seconde, on pourrait la décrire comme être un oiseau dans la paume de la main de Dieu – un sentiment d’être dans un berceau.
À lire aussi : Working Class Heroes : rencontre avec David Joy, Sébastien Dulude, Michael Magee et Glen James Brown
Et justement, le corollaire de ce sentiment d’enfermement et de prison, c’est ce qu’on voit dans vos romans. C’est souvent que les gens pensent que pour s’en sortir, il faudrait aller ailleurs. Il y a quelque chose d’assez hypothétique, mais il y a toujours l’ailleurs, comme une idée de renaissance. Alors qu’on se doute à peu près bien que, ailleurs, ça ne sera pas forcément mieux. Mais ils se disent, si j’arrive à partir, tout ira mieux.
Oui. Il me semble que dans tous les romans que j’ai écrits, il y a un thème principal, un thème qui sert un peu de toile de fond, qui est l’isolement économique et l’incapacité à survivre, à s’en sortir dans cet endroit, à cause de cette situation économique. Et les gens qui s’en sortent, en fait, ce sont ceux qui viennent de l’extérieur, qui arrivent, qui sont riches et qui accaparent la terre et qui déplacent les personnes qui sont originaires de cet endroit, si bien qu’on en arrive à une perte culturelle. Et je pense qu’on a quasiment atteint une sorte d’extinction sur le plan culturel. Je pense que d’ici une génération, on verra vraiment cette extinction culturelle. Ce que je veux dire par là, c’est la perte de ce que ça représente de venir de cet endroit.
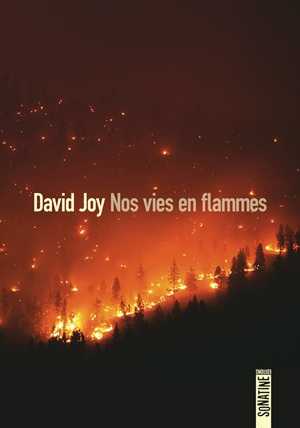
Oui, vous en parlez très bien dans vos romans. C’est assez particulier de voir cette perte de repères, la fin d’une culture – sans vouloir généraliser sur les Appalaches, comme vous le dites.
Je pense qu’on peut faire un certain parallèle avec l’époque du Covid à Paris. On a vu que les gens ont quitté Paris et sont allés à la campagne. Et en conséquence, le prix de l’immobilier a énormément augmenté, si bien que les gens du coin ne pouvaient plus se permettre d’y habiter ou d’acheter eux-mêmes. On voit que lorsqu’il y a un déplacement, à cause du fait que certains sont plus privilégiés, ce qu’on perd est irréparable. Il y a des choses qu’on ne peut jamais retrouver. Et pour moi, ce sont ces choses auxquelles j’attache le plus de valeur.
Oui, ce phénomène de gentrification que nous pensions juste urbain, se retrouve à des échelles beaucoup plus larges, telles que le comté où vous vivez. C’est tellement angoissant.
Oui, je dirais que ma plus grande peur, c’est justement cette espèce d’homogénéisation qu’on voit. Moi, je ne veux pas venir ici et devoir acheter mon fromage à Monoprix. Ce que je voudrais, c’est acheter mon fromage dans cette petite ville que je vous ai montré tout à l’heure sur mon portable, dans le Pays basque. Et ça me terrifie vraiment, cette perte qu’on constate, que ce soit au niveau des accents, des langues ou de la nourriture. Je pense que ce sont des biens dont on ne peut pas mesurer la valeur, qui sont inestimables en fait. Je pense aux langues, le breton, le basque, qui sont effacées. Et tout ça nous pousse à une espèce d’uniformisation. On est tous pareils. Il y a vraiment une perte d’identité, une perte de ce que ça représente de venir d’un endroit.
Pour revenir sur cette « envie d’ailleurs », on voit dans vos romans des gens qui se sentent emprisonnés sur leur territoire, une prison « géographique », si on peut dire, mais aussi des gens qui sont confinés par leur déterminisme. On croise de nombreux personnages qui sont marqués par leur famille. Et leur famille étant ce qu’ils sont, eux ne peuvent faire que ce que veut la famille.
Oui. Il y a une poète du Kentucky qui s’appelle Rebecca Gayle Howell qui écrit que l’espoir est la ressource des privilégiés. Je pense que ce qu’elle dit est vrai. Par exemple, la capacité de rebondir lorsqu’on a perdu un emploi : « Je vais en trouver un autre, c’est pas grave. » Ou de ne pas se soucier de son prochain repas. Il me semble que ça, ce sont des privilèges. La plupart des personnages au sujet desquels j’écris dans mes romans sont pauvres. Ils n’ont pas ces privilèges.
Ça me rappelle ce que disait Kem Nunn, dans La Reine de Pomona, à propos de la désindustrialisation, qu’on peut comparer aujourd’hui avec la bulle économique qui a explosé comme vous le racontez dans vos romans. Il expliquait très bien le fait que lorsqu’un phénomène majeur arrive – la fermeture d’une usine, par exemple – certains ont la capacité de rebondir, peuvent partir pour aller refaire leur vie ailleurs, parce qu’ils ont certaines compétences. Et il y a plein de gens qui, entre guillemets, n’ont pas ces capacités et cela n’a rien de péjoratif. Ils savent très bien que ce n’est pas la peine qu’ils partent, parce que s’ils se déplacent de 200 km, et bien il y aura déjà des gens comme eux qui pourront faire ces petits boulots. Donc le seul choix qu’ils ont, c’est de rester, tenter de survivre dans ce qui reste…
Exactement. On voit aussi la même chose se produire avec certaines catastrophes naturelles. Je pense à l’ouragan Katrina. Tous ces gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu des êtres aimés, qui ont tout perdu. Et c’est vrai que vu de l’extérieur, on peut se demander pourquoi ils ne sont pas partis. Et en fait, ils ne sont pas partis parce qu’ils ne pouvaient pas. Ils n’avaient pas la ressource de partir. Et c’est vrai que c’est difficile à comprendre pour certains qui n’ont jamais été obligés de regarder le monde à travers le même prisme.
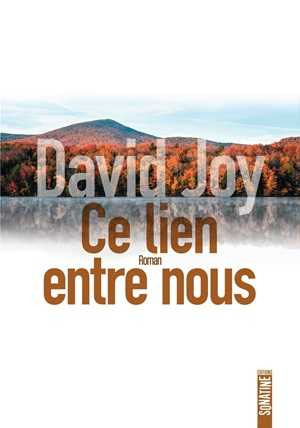
La puissance des livres
Et Katrina, en plus, on voit comment tous les spéculateurs sont arrivés pour réorganiser la ville. Mettre tout le monde dehors et reconstruire pour de nouvelles populations. Je pense à la superbe série de David Simon, Treme…
Mais, pour revenir sur les romans, en les relisant tous cet été – ce qui permet de voir vraiment l’œuvre dans sa continuité – j’ai été frappé par puissance de vos titres. Quand on regarde vos cinq titres, on a l’impression que chacun est un résumé des points marquants de votre œuvre.
Oui. J’ai vraiment aimé la traduction française des titres, par exemple, Nos vies en flammes [en anglais : When These Moutains Burn]. J’aime beaucoup, vraiment, ces traductions de titres en français. Je pense qu’ils gardent la poésie que mes titres évoquent. Mais ceci dit, je pense quand même qu’il y a une certaine perte qui s’est opérée entre l’original et la traduction. Et cela concerne la spécificité de l’endroit dont je parle. Je parle de ces montagnes d’où je viens, de ce monde dans lequel je vis, de la terre qui nous unit, nous. Et c’est vrai que tous mes titres essayent d’enfoncer le clou, de dire que je parle d’un endroit précis, de cet endroit. Et c’est important pour moi. Ceci dit, j’aime beaucoup les titres en français, ce sont comme des nouveaux titres.
Votre premier livre date de 2015. Là, on en est au cinquième, en 2024. C’est un sacré rythme d’écriture, a fortiori quand on voit la puissance de chaque roman. Parce que des auteurs qui produisent des livres à la chaîne standards, il y en a plein, mais arriver à en faire cinq, aussi denses, aussi forts en moins de dix ans, c’est vraiment une sacrée prouesse, comment faites-vous ?
Mon rythme naturel est plutôt lent. Je ne suis pas le genre d’écrivain qui écrit tous les jours. J’ai compris très tôt que j’avais besoin de temps, que le processus en moi, était un processus lent. Et j’ai fait confiance à ce processus, de façon très profonde. Il y a un écrivain, James Still, du Kentucky, à qui on posait la question : « À quelle fréquence écrivez-vous ? », et il a répondu « J’écris vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. » Mais en fait, ce qu’il voulait dire, c’est qu’il avait tout le temps présents à l’esprit l’histoire, les personnages, même quand il n’écrivait pas. C’est tout à fait comme moi. Je reste très longtemps avec mes personnages, je prends le temps de les connaître, jusqu’à ce qu’ils deviennent presque comme une famille pour moi. Je les connais de façon intime. Et ce n’est qu’à ce moment-là que je m’assois et que je les couche sur le papier.
Du coup, cela part vraiment des personnages. C’est lorsque vous avez tous ces personnages qui sont là que l’histoire commence à rentrer ?
Oui. Par exemple, imagine que tu cherches à décrire une scène, dans un train, un train bondé où il n’y a pas de place. Tu vois un homme qui se montre grossier envers une vieille femme. Là, je te demande, qu’aurait dit ton père ? Qu’aurait dit ta mère ? Toi, tu sais exactement ce que ton père ou ta mère aurait dit, parce que tu connais tes parents. Et bien, c’est ce genre d’intimité que j’ai avec mes personnages. C’est à dire que quand tu connais tes personnages, en fait, ils te guident sur le papier. Tu peux les suivre de façon aveugle. Tu peux les mettre dans n’importe quelle situation. Que ce soit en train de commander un repas ou sous la douche, tu sais quelle nourriture ils vont commander, tu sais quelles chansons ils vont chanter sous la douche. Tu connais leurs réactions, tu les connais avec cette intimité-là.
Cette crise d’opioïdes était vraiment devenue partie intégrante de mon quotidien. […] Quand j’allais à la poste et que je descendais de mon camion, je voyais des aiguilles sur le parking.
Je trouve qu’il y a un personnage marquant – enfin, il y a plein –, c’est le personnage de Ray dans Nos vies en flammes, qui est vraiment beau dans son rapport avec son fils. C’est aussi lié à votre façon d’écrire, car ce n’est pas Ray qui parle, mais votre façon d’écrire « Le garçon » dans ses pensées et rien qu’avec ça, on voit toute la filiation, tout le rapport qui est entre les deux, et c’est magnifique.
Oui, ce roman en particulier, a été légèrement différent pour moi. C’était spécifiquement cette relation que je voulais explorer. Une grande part de mon écriture a à voir avec les addictions. L’addiction est quelque chose que je comprends très bien. Mais ce que je ne comprenais pas, c’était ce que ça pouvait faire d’être parent de quelqu’un qui est addict, une personne dépendante. Et c’est cela qui a alimenté mon roman. Je voudrais vous raconter l’histoire d’une femme qui a lu ce roman et qui a vu son fils mourir d’une overdose. On était en train de lever des fonds pour une ONG qui se consacre à la cause des addictions, et cette femme m’a raconté qu’à chaque fois que son fils retombait dans la dépendance, il vendait sa guitare. Et elle, ce qu’elle faisait, c’est qu’elle rachetait la guitare. Elle la gardait jusqu’à ce que son fils s’en sorte un peu, et quand il allait mieux, elle lui rendait. Pendant un temps, il était bien, et puis après, il retombait dans l’addiction. Alors il revendait sa guitare à nouveau, et elle, elle retournait la racheter. Cette histoire, c’est un peu le cœur de ce que j’ai voulu faire dans Nos vies en flammes.
Oui, c’est ça, c’est ce que vit Ray. C’est à dire que quoi que son fils fasse, qu’importe ses gestes les plus insensés, les actions qu’il ne peut plus supporter, à l’arrivée, il reste son fils. Et là, on ne peut pas lutter.
Si vous l’abordiez plus ou moins dans vos autres romans, Nos vies en flammes, est vraiment le livre centré sur les ravages des différentes drogues. Sa version poche est augmentée d’un article que vous aviez écrit sur les opioïdes et qui est sorti dans la revue America. Tout ceci donne un concentré de la situation actuelle.
La crise des opioïdes aux États Unis, cette épidémie, a été quelque chose de très ciblé. Ce que je veux dire, c’est que quand on regarde la carte géographique de la répartition de ces opioïdes, ma région apparaît comme un bleu sur la peau. On voit vraiment comment les grandes entreprises, l’industrie pharmaceutique a ciblé de façon systématique certains groupes de personnes qui n’ont pas de voix, ceux qui ne peuvent pas se faire entendre. Comme si ces personnes, en fait, étaient à usage unique, comme si on pouvait s’en passer. Et ce roman est parti de là. Car cette crise d’opioïdes était vraiment devenue partie intégrante de mon quotidien. C’était devenu impossible de l’ignorer. Quand j’allais à la poste et que je descendais de mon camion, je voyais des aiguilles sur le parking. Quand je traversais la ville dans ma voiture, je voyais des médecins qui sortaient des corps de sous les ponts, des corps de personnes décédées d’overdose. J’ai perdu des membres de ma famille, j’ai perdu des amis… Alors que tout ceci aurait pu être évité.
Les Deux Visages du monde
Nous allons terminer sur votre dernier roman, Les Deux Visages du monde, qui prend une dimension différente, dans le sens où on reste dans votre comté, chez les gens que vous connaissez, mais avec des propos qui ont une dimension nationale, si on peut dire. Et nous y voyons tout le travail sur le questionnement de l’histoire de l’Amérique.
Vous avez raison. Mes deux derniers romans sont d’un genre plus sociétal, je dirais, par rapport aux trois premiers, Ce lien entre nous traite de la crise des opioïdes et Les Deux Visages du monde de la suprématie blanche et du racisme systémique.
L’enjeu dont vous parlez est le suivant : dans le sud des États-Unis, on nous a appris une histoire fausse. J’ai peut-être l’air âgé, mais je ne le suis pas tant que ça. J’ai eu mon diplôme universitaire en 2002. Et, à l’école, quand j’étais petit, on m’apprenait que la guerre civile n’avait rien à voir avec l’esclavage. On a enseigné la même chose à mes parents. Leurs parents ont appris la même chose. Et donc vous avez ce mensonge générationnel qui a été propagé et qui devient très difficile à démêler, parce que vous parlez de choses qui semblent fondamentales aux gens pour leur compréhension de l’éducation. Et lorsque ces choses sont remises en question, vous pourriez aussi bien leur dire que deux plus deux n’est plus égal à quatre.
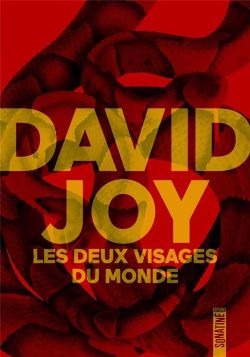
Votre roman aborde ces questions majeures qui divisent véritablement les États-Unis, mais sans aucun manichéisme.
Je pense que l’écrivain ou l’artiste travaille mieux quand il reste un peu dans une zone grise. Je me souviens d’avoir lu une étude psychologique sur les artistes. Ils avaient pris des peintres, des sculpteurs, des écrivains, et l’hypothèse était qu’en les étudiant, on démontrerait que ces personnes-là avaient un taux de maladie mentale plus élevé. Mais en fait, non, la conclusion était que ces personnes avaient une plus grande capacité à voir le monde avec ambiguïté. Et c’est ça qu’il faut faire en tant qu’écrivain, rester dans le gris. Vous ne pouvez pas partir dans un sens ou dans l’autre, vous devez rester dans la zone grise.
C’est ce qui manque cruellement aux gens aujourd’hui, parce qu’on voit très bien votre pays divisé. Ce que résume très bien une phrase de votre roman : « Du jour au lendemain, un fossé se creusa dans le comté et coupa la montagne en deux. »
Je crois que le rôle de la littérature est de créer un espace sûr dans lequel on peut s’asseoir et réfléchir à des idées difficiles et inconfortables et qui vous remettent un peu en question. Il y a un écrivain, George Saunders, qui a écrit que la fiction, quand elle est réussie, a la capacité de servir de roue d’entraînement à l’empathie. Et moi je pense que c’est vrai. Je pense que cette idée de sécurité est importante, et elle pourrait l’être encore plus pour les Américains. Je pense que les Américains ont perdu, il y a longtemps, la capacité à avoir un discours civil. Si nous nous asseyons à table et que nous avons une discussion, on va finir par hurler et se taper dessus. Alors que si on s’assoit avec un livre, et que le livre est l’espace qui crée cette conversation, vous pouvez vous mettre en colère, vous pouvez jeter ce livre à travers la pièce, vous pouvez le déchirer en morceaux, mais à la fin de la journée, il n’y a que vous qui allez vous asseoir et rester avec ça. Et réfléchir, et vous demander pourquoi j’ai ressenti ça ? Pourquoi est-ce que j’ai réagi de cette façon-là ? Et c’est cela que la littérature a la capacité de faire.
Merci à Sonatine et à Guillemette Monge-Romero qui a traduit les propos de David Joy.
Pour aller plus loin
Tous les romans de David Joy sont publiés chez Sonatine. Les quatre premiers sont traduits par F. Pointeau, le dernier par J.-Y. Cotté.