L’auteur, installé au Québec depuis près de quinze ans, signe un second polar, Les Corps sur la neige chez Robert Laffont, sur fond de mafia et corruption, plongeant dans l’histoire d’un des plus gros scandales de la construction au Québec.
Nous avions rencontré Stéphane Ledien il y a quelques années à l’université de Chambéry lors d’un colloque intitulé « Roman noir et journalisme : en quête de vérité ». Nous avions sympathisé avec l’auteur, docteur en littérature, lors de cette excellente journée – c’est toujours un plaisir de parler polar avec des gens qui aiment ça. Après la lecture de ce dense Les Corps sur la neige, nous avions quelques questions à lui poser à son sujet.
Milieu Hostile : Pour en savoir plus sur vous, on peut aller faire un tour sur votre site. Mais votre biographie n’aborde pas votre thèse en études littéraires. Pourriez-vous nous en parler, car en remerciements de votre roman, vous dites que celui-ci en est l’aboutissement de quatre années de travail.
Stéphane Ledien : J’ai soutenu ma thèse de doctorat en études littéraires à l’automne 2021 à l’université Laval, à Québec. Il s’agissait d’une thèse dite de « recherche-création » que j’avais commencée en 2015. Cette thèse comportait deux volets : une partie essai, qui était consacrée à ce que j’ai appelé l’« ironihilisme » dans le roman noir français du XXIe siècle, et une partie écriture de fiction. Ce volet création a justement été la matrice de ce qui est aujourd’hui Les Corps sur la neige. Mes travaux de recherche au sujet du polar ont nourri ma propre pratique créative. Et inversement, l’écriture d’une fiction dans un cadre « scientifique » à l’université a éclairé des enjeux que la recherche pure n’aurait sans doute pas fait ressortir.
J’avais déjà publié, hors contexte universitaire, quatre ouvrages de fiction, dont un roman à la lisière du fantastique (Bleu tout-puissant) et un polar (Sur ses gardes). Là, il fallait que je fasse le grand écart : d’un côté, j’avais à réfléchir au genre policier en m’appuyant sur des outils d’analyse opérants ; de l’autre, je devais contribuer à ce genre en termes créatifs et de façon originale.
La partie « essai » explorait les crises sociales mises en scène par le roman noir français de l’extrême contemporain, tout en examinant les tensions éthiques et esthétiques qui habitent le genre. J’ai notamment étudié comment des auteurs tels qu’Antoine Chainas, DOA, Jérôme Leroy, Dominique Manotti, Elsa Marpeau et quelques autres (Thierry Marignac, Frédéric Jaccaud, Benoît Philippon…) subvertissent les positions énonciatives (et parfois idéologiques) qui ont cours dans le polar français plus grand public.
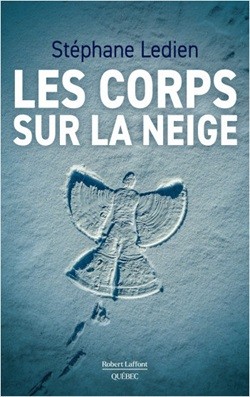
Comment avez-vous articulé tout ça ? Car vous écrivez aussi qu’il vous a fallu trois ans de réécriture. Comment êtes-vous arrivé à porter un tel projet pendant sept ans en gardant la motivation et la même tonalité d’écriture ?
Le chantier d’écriture a vraiment débuté en 2017, après que j’avais fait beaucoup de recherches. La « première » version des Corps sur la neige date de 2020. Elle était beaucoup plus longue que le roman actuel. Deux cents pages de plus, au bas mot ! Je mets des guillemets à « première », parce que lorsque j’ai soutenu, puis déposé ma thèse à l’automne 2021, le texte du roman avait été maintes fois remanié, ajusté en fonction des remarques de mes directeurs de recherche et des membres du jury de ma soutenance de doctorat. Il a existé au moins trente versions du roman ! Je suis parti d’une intrigue très, trop complexe et je l’ai épurée, resserrée. J’ai supprimé des enjeux, quelques épisodes plus intimistes, etc. En 2021, au moment de la publication de la thèse, j’étais, je pense, arrivé à un roman solide. Sa densité avait quelque peu gêné ceux qui s’étaient penchés dessus, mais, quand tu lis du Don Winslow ou du DOA, tu comprends que la densité n’est pas forcément l’ennemie de la qualité ou de la clarté. Après ma soutenance et l’obtention de mon doctorat, le roman a circulé chez des éditeurs. Dès 2021, une éditrice française était intéressée et puis, du jour au lendemain, pouf ! Plus de nouvelles. Le texte a circulé encore. Au printemps 2023, un an et demi s’était écoulé depuis la parution de ma thèse. Voyant que les éditeurs restaient frileux ou pas tout à fait convaincus, je me suis remis au travail. Richard Migneault, qui m’avait dirigé dans le cadre du recueil jeunesse Les Nouveaux Petits Mystères à l’école, a accepté de lire et de commenter mon manuscrit. Il me l’a renvoyé avec des remarques intéressantes et des suggestions d’ajustement. J’ai décidé de faire beaucoup plus que ce qui était annoté. J’ai coupé des passages, en ai réécrit d’autres, modifié le début, changé le titre – c’était une manière de le voir comme un nouveau roman plus que comme une « nouvelle nouvelle » version. J’ai ajouté quelques petits trucs par-ci par-là, mais surtout supprimé tout ce que maintenant je voyais comme superflu. Je voulais revenir à quelque chose de plus sec, sans perdre de vue l’aspect contemplatif par endroits. Je me suis dit que chaque chapitre devait nous tenir en haleine. À l’été 2023, je suis parvenu à une énième version que j’ai soumise à Robert Laffont Canada. Et voilà ! Jean Bouchard, le directeur de Robert Laffont Canada, m’a confié qu’il avait trouvé le texte « très abouti ». L’équipe m’a bien sûr demandé d’opérer quelques retouches et corrections ; il fallait notamment que ce soit plus québécois dans certains échanges entre les personnages.
Plus de quatre cents pages, cent chapitres, un scénario aux histoires multiples et ramifications complexes, on vous voit bien sept ans enfermé dans votre bureau avec un énorme plan au mur, des post-it (enfin, des petits papiers autocollants), des fiches personnages, des plans, des livres de documentation… Serait-ce une image fantasmée par le cinéma ?
Au début du projet en 2017, je me suis lancé sans filet, en étant guidé par l’instinct et en ne perdant pas de vue mes recherches documentaires. Mais au bout de quelques mois, oui, je me suis aperçu que j’avais pas mal d’intrigues et de personnages, et qu’il fallait que je voie très concrètement qui agissait pour ou contre qui et pour quelle raison ! J’ai un peu honte de l’avouer, mais en général, j’écris sans avoir élaboré de plan. Il y a bien une trame qui se dessine dans ma tête, oui, mais je ne la détaille pas sur papier ni même dans un tableau Excel. Cette fois-ci, à un moment où j’avançais bien dans l’histoire, je me suis dit : « Attends, là, ça devient chaud. » Notamment en ce qui concerne le crime organisé ! J’ai dessiné au brouillon un organigramme et, surtout, j’ai rédigé un synopsis assez long (une vingtaine de pages) de ce qu’il adviendrait par la suite. Finalement, je n’ai pas du tout, mais alors pas du tout respecté ce « scénario » ! Ça allait trop loin, une vraie saga Netflix ! Mais le fait de coucher tout ça par écrit m’a permis de voir plus clairement les enjeux et les liens entre les personnages. L’écriture est un long processus pour moi. Plus ça va, plus je prends mon temps. Je confie volontiers que je suis un « écrivain lent » ! Blague à part, pendant que je rédigeais ce roman noir, je publiais aussi beaucoup d’articles dans des revues littéraires, préparais des communications pour des colloques. Et tout ça, en plus des cours que je donnais à l’université, d’un travail à temps partiel dans le commerce de détail et de mon activité de rédacteur professionnel. J’alternais entre longues plages d’écriture et grappillages de minutes propices à la relecture et au « retravail » de ce dont j’avais accouché peu de temps auparavant. Après coup, je garde en mémoire les images romantiques – mais vécues pour de vrai, je précise –, de moments d’écriture inspirés par les couleurs de l’automne et les tempêtes de neige à Québec. Ambiance qui, je crois, se retrouve dans le roman et déteint même sur les personnages.
En parlant de personnages, comment avez-vous abordé cette multiple galerie de protagonistes ? Car chacun est dense et bien construit.
Thériaux, le déneigeur de toits au passé militaire un peu trouble, je l’ai imaginé assez vite, mais il m’a fallu du temps pour apprivoiser son image, son caractère. Il est resté un petit bout de temps insaisissable, mais, au fil de la rédaction, ses postures, ses traits physiques et psychologiques se sont affinés, sans qu’il perde de son mystère. Riley Lewis, l’Américaine du NY Times, par contre, je l’ai « sentie » dès le départ, peut-être parce qu’elle n’occupait pas le rôle principal à ce stade de l’écriture. Ses attitudes, son caractère, ses paroles me venaient plus facilement que pour Thériaux. Pour les autres, par exemple l’homme de main Domenico, le mafieux Tony Volpino, le « boss » Salvatore Bonura, ils sont en partie le fruit de toutes les fictions policières que j’ai vues ou lues dans ma vie. Mais il faut « digérer » les références. Quand j’imagine un personnage, je commence par entendre sa voix et je vais immédiatement chercher au fond de lui les petits « trucs » qui le rendent différent, voire unique : son humour, ses vacheries, ses attraits – ou son manque d’attraits ! Un « bon » personnage, c’est forcément quelqu’un qui va te faire réagir d’une façon ou d’une autre. Donc, quand j’écris je suis attentif à ce que le personnage cherche à exprimer spontanément et je construis peu à peu autour de ça. Pour Riley, je me suis aperçu en cours d’écriture d’une transformation que je n’avais pas préméditée : à un moment, le narrateur anonyme se met à l’appeler Riley alors que pendant X pages, depuis le début, il la désignait par son nom de famille. Quand je m’en suis rendu compte, j’ai décidé de laisser ça tel quel. Ça voulait dire que le récit franchissait un cap de proximité avec ce personnage.
À lire aussi : Interview avec Andrée A. Michaud : Bondrée et Lazy Bird
Ce roman vient prendre ses racines dans le grand scandale de la corruption dans le milieu de la construction au Québec. Pourriez-vous revenir dessus ? Car c’est visiblement un événement majeur de ces cinquante dernières années.
Le Québec a connu, au fil des décennies, moult commissions d’enquête sur la corruption qui pouvait sévir dans l’industrie des travaux publics et ailleurs. Tout ça ne date pas d’hier. Ce qu’on a su des pratiques mafieuses à New York s’est aussi retrouvé à Montréal. Montréal a toujours eu un côté « ville ouverte » au crime organisé. Il est de notoriété publique que la métropole a longtemps été (et est sans doute encore) une plaque tournante de la drogue en Amérique du Nord et qu’elle est liée au clan Bonanno. La commission Charbonneau, dont il est question dans le roman, remonte au début des années 2010. Une décennie plus tôt avaient éclaté plusieurs scandales de collusion dans les contrats de la construction publique. Des élus – dont le maire de Montréal Gérald Tremblay qui, en raison de cette corruption, a dû démissionner en 2012, ou encore le maire de Laval Gilles Vaillancourt – et des fonctionnaires municipaux au Québec touchaient des pots-de-vin pour favoriser (en lui accordant aussi des surcoûts) telle ou telle entreprise généralement infiltrée par le crime organisé. En 2011, le gouvernement du Québec a donc décrété une commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats de construction publique. La commission a été appelée plus familièrement « commission Charbonneau » – du nom de la juge qui la présidait. Ç’a aussi été un cirque médiatique : on a vu défiler à la barre de nombreux entrepreneurs dont certains ont avoué avoir côtoyé ou « favorisé » des truands. Aucun roman n’avait abordé la Commission en tant que telle. J’ai trouvé que ça ferait une très bonne toile de fond. Et puis, c’était récent et ça tombait bien : je voulais un roman très actuel, pas quelque chose de nostalgique ou d’historique (même si j’adore les récits ancrés dans une autre époque).
Et derrière, la mafia, déjà présente dans les années 1970, les cartels… on est loin de l’image d’Épinal du Québec… À ce sujet, quels ont été les retours sur place ?
Oui et aux clans mafieux et aux cartels, il faut ajouter les gangs de rue et surtout les gangs de motards, lesquels se sont d’ailleurs livrés une véritable guerre de territoires (de revente de drogue, notamment) dans les années 1990. Il fait bon vivre au Québec, évidemment, mais ça fait partie du jeu pour un auteur de polars, d’aller chercher la petite bête : corruption des uns et des autres, malversations de la part des dirigeants et ramifications à ce qu’on pourrait appeler « l’internationale du crime ». Couleur locale et noirceur globale ! Le roman a été très bien reçu par les critiques et le public québécois. Norbert Spehner lui a mis un 10/10 ! J’ai eu de belles appréciations de la part de personnalités du polar comme Chrystine Brouillet, sans compter quelques belles recensions, par exemple dans Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, les quotidiens francophones les plus lus au Canada. Les commentaires les plus récurrents ont trait au côté page turner du roman, ce qui est un beau compliment. Je suis très heureux de l’accueil qu’a reçu le livre. Je me sens choyé, vraiment !
Et pour finir, votre précédent roman Sur ses gardes était le premier tome d’une trilogie, votre prochain roman en sera-t-il le deuxième ?
Oui ! Là encore, le processus s’avère long. J’ai commencé à écrire le deuxième volet du cycle Eddy Barcot dès 2016, mais, pendant mon doctorat, je l’ai mis de côté, en y revenant de temps à autre, pour me concentrer sur Les Corps sur la neige. J’ai bien essayé de mener de front les deux projets, mais ça ne fonctionnait pas. Je ne suis pas Dostoïevski ! En quelques années, je suis arrivé à plus de 350 pages. Mais je suis en train de le réécrire, de le resserrer. D’abord, parce qu’entretemps, mon écriture s’est transformée. Ensuite, parce que mon éditeur à qui j’ai commencé à en parler m’a incité à ne pas dépasser un certain seuil de mots ! Honnêtement, le « resserrage » a du bon. Alors voilà ! J’espère terminer cet automne l’écriture de ce roman dont une partie se déroulera à New York.
Pour aller plus loin
Les Corps sur la neige chez Robert Laffont, son éditeur
Les textes du colloque, Roman noir et journalisme : en quête de vérité, réunis et édités par Myriam Roche et Émilie Guyard, sont publiés par les Presses universitaires Savoie Mont Blanc
