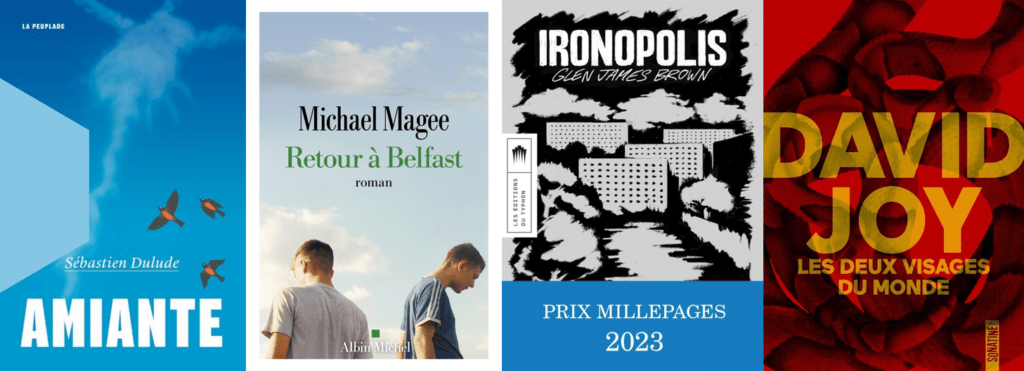Lors du festival America 2024, nous avons animé une rencontre sur la classe ouvrière en compagnie des auteurs Sébastien Dulude, Michael Magee, Glen James Brown et David Joy. À travers leurs livres et leurs personnages, que disent-ils des travailleurs, des oubliés et des gens de peu ?
Si David Joy présente son cinquième roman, les trois autres sont des primo-écrivains. Pour autant, ils partagent tous le fait d’être attachés au lieu sur lequel ils écrivent, aux gens qui le peuplent et au fait de faire entendre la voix de ce collectif. Tous ces auteurs ont des univers denses et fourmillants. À travers le monde, à travers différentes voix, différents personnages et différentes expériences, ils nous donnent une représentation de la classe ouvrière aujourd’hui. Qu’en est-il ? Qui sont tous ces gens qui travaillent, et toutes ces voix qui en parlent dans ces livres ?
Sébastien Dulude vient du Québec. Amiante, magnifique roman, à la plume extraordinaire, se passe dans les villes qui côtoient les mines d’amiante. Si c’est un environnement qui permet aux enfants de s’amuser dans les collines de résidus, il n’en reste pas moins que les sols sont dangereux, l’amiante reste l’amiante.
Michael Magee, avec Retour à Belfast, raconte le retour dans cette ville de son protagoniste principal, et nous parle des vies de petits boulots, des nuits longues, des matins difficiles et de cette population invisible qui tente de résister. Avec une très belle plume, il nous embarque dans un rythme frénétique.
Glen James Brown dans Ironopolis, un roman très impressionnant, crée une ville fictive centrée autour d’usines industrielles qui ferment. L’environnement se désagrège et, en arrière-plan, nous voyons les politiques menées par les différents gouvernements qui vont traverser ce milieu social, raser les logements. C’est un roman dense, qui captive, prend et qui est aussi traversé par des épisodes fantastiques.
Et puis David Joy, cinq romans derrière lui, dont le dernier, Les Deux Visages du monde. Il parle dans ces cinq romans de son comté où il a toujours vécu. Son ambition n’est pas de raconter la vie dans les Appalaches, trop vaste, mais de parler de son comté, des gens qui le peuplent, qu’il connaît, et qui fait qu’il sait de quoi il parle.
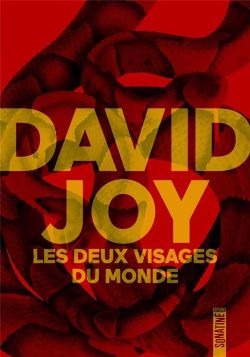
Christophe Dupuis : Ce qui est vraiment très intéressant, c’est que vos romans ne sont pas des livres sur les conditions de travail, ce sont des livres sur les gens de la classe ouvrière et par là, on voit comment, justement, leurs métiers conditionnent leur vie.
Commençons par Sébastien Dulude, avec son roman Amiante, qui fait le portrait de deux adolescents dans les années 1980 vivant à proximité de mines d’amiante. Vous abordez cette thématique d’une façon originale, très poétique. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre roman ?
Sébastien Dulude : L’idée de départ était d’explorer l’enfance dans un contraste qui serait extrême, une enfance idyllique avec deux amis qui se trouvent au cœur de l’été. Ils fusionnent, restent ensemble sur un territoire, qui était celui de mon enfance aussi, avec lequel j’ai un rapport un peu contradictoire parce que je n’en étais pas natif. Mais j’ai adoré dès la première seconde où nous nous sommes installés là-bas. C’est un paysage montagneux, vallonné, avec des forêts immenses, des couleurs à l’automne qui changent, qui sont magnifiques. Des forêts de pins également. Mais dès qu’on arrive en voiture, on commence à voir apparaître les collines grises. C’est surtout ça qu’on voit au début. Nous, on les appelle les dombes, en France vous dites des terrils. On voit moins les puits au départ. S’il y a ces collines, c’est parce qu’on a extrait l’amiante à partir de cratères à ciel ouvert. Les puits comme ça, il y en a une dizaine, peut-être dans la région de Thetford Mines. C’est un environnement où l’on voit moins les cratères, on peut seulement les voir en avion. C’est difficile de s’en approcher, mais on les entend. C’est à dire que c’est une extraction avec de la machinerie lourde d’un calibre extrême, des camions qui ont des capacités de charge de 45 à 100 tonnes. Et ça creuse comme ça tous les jours. On entend continuellement le vacarme, les camions au loin, avec un système d’écho qui provient du cratère. Il y a un dynamitage aussi, une explosion littéralement, qui fait descendre un plan du cratère à 16h tous les jours. Donc ça, c’est l’ambiance quotidienne. Et le dimanche, la mine ferme. On entend tout s’éteindre le samedi, à minuit. Je me souviens d’entendre ce silence qui révélait la nuit, ce qui devrait être un peu le contraire. Et là, le dimanche, les enfants allaient explorer les environs. Mais, comme je le disais, les mines ne sont pas particulièrement accessibles. C’était hyper gardé, hyper connecté. La police vielle. Car c’est un trésor. Il faut bien penser que l’amiante, c’est de l’or blanc.
 Lorsque je suis arrivé, c’était un peu le début de la fin de cette industrie. C’était une matière qu’on protégeait. Mais, par contre, les dombes de résidus, il était assez facile d’y accéder. On y allait en vélo, en moto-cross. On les grimpait. On savait très bien que c’était toxique. C’était la fin de cette industrie, parce qu’il n’y avait plus de clients. Mondialement, la commande avait chuté parce qu’on découvrait la toxicité de ce matériau. On le savait depuis des années, mais on a tenté d’exploiter ça le plus longtemps possible. Et ça, c’est la même chose pour les mines de charbon, ou n’importe quel autre matériau toxique.
Lorsque je suis arrivé, c’était un peu le début de la fin de cette industrie. C’était une matière qu’on protégeait. Mais, par contre, les dombes de résidus, il était assez facile d’y accéder. On y allait en vélo, en moto-cross. On les grimpait. On savait très bien que c’était toxique. C’était la fin de cette industrie, parce qu’il n’y avait plus de clients. Mondialement, la commande avait chuté parce qu’on découvrait la toxicité de ce matériau. On le savait depuis des années, mais on a tenté d’exploiter ça le plus longtemps possible. Et ça, c’est la même chose pour les mines de charbon, ou n’importe quel autre matériau toxique.
L’idée de départ de ce roman était de camper quelque chose d’extrêmement doux dans un milieu violent. Et comme tu le disais en introduction, ce n’était pas tant pour décrire les conditions de travail dans ce milieu-là. Mais de voir comment ce background qui devient presque invisible, qu’on oublie, agit quand même. Surtout, c’est une force qui traverse les personnages. Et j’ai posé mon personnage principal, dans une intimité avec son amitié, dans une intimité familiale, dans des cellules plus réduites, mais qui montrait quand même combien la violence des critères industriels pénétrait ces différents cercles.
L’idée de départ de ce roman était de camper quelque chose d’extrêmement doux dans un milieu violent.
Sébastien Dulude
C. D. : Michael Magee, avec Retour à Belfast, vous brossez le portrait de différents protagonistes qui exercent une multitude de petits métiers qui ne sont pas reconnus, qu’on ne voit pas.
Michael Magee : Le protagoniste principal, Sean, est une des rares personnes dans son milieu à avoir un diplôme universitaire. Mais il est contraint par des circonstances économiques à retourner à Belfast. Et de manière insidieuse il retombe dans des modes de vie auxquels il avait décidé d’échapper. Donc, il accomplit plusieurs petits boulots, les boulots dont personne ne veut, il travaille dans les bars, dans les boîtes de nuit… C’est vraiment le genre de travail parfaitement précaire que l’on peut perdre d’un instant à l’autre. Et c’est une expérience qui n’est pas reconnue au plan social, qui a ses limites. Elle est le propre de quiconque cherche sa voie à tâtons. Et à travers ses tentatives de franchir ces barrières de classe, Sean est confronté à plusieurs difficultés qui tiennent non seulement au milieu social, mais aussi à la masculinité. Il retrouve cette vie et ses conditions particulièrement difficiles. Et ses expériences, petit à petit, vont structurer sa vie. Il ne perd pas néanmoins son inspiration à exercer un autre métier dans le milieu de l’art, celui des expositions artistiques, mais il est confronté à la réalité et il sait qu’il n’obtiendra jamais cet emploi. Parce que tous ses marqueurs sociaux sont aussitôt visibles chez lui, dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter. Et c’est ce malaise croissant que le roman explore.
C. D. : Glen James Brown, avec Ironopolis, vous proposez un roman choral avec six protagonistes qu’on croise, six voix différentes qui œuvrent dans cette cité qui est en train de disparaître.
Glen James Brown : L’histoire est racontée à travers la perspective de six personnages différents. Le roman se déroule sur environ quatre-vingts ans. Et tout au long du roman, on revisite les mêmes lieux, les mêmes événements, les mêmes choses se reproduisent, et sont à chaque fois vues selon des perspectives différentes. Et, selon la perspective qui change, on voit les événements d’une manière différente. C’est une histoire qui m’intéressait parce que ça parlait de ce lieu où j’ai grandi, c’est à dire une grosse cité de logements sociaux. Et c’était vraiment comme ça que ça se passait, c’est à dire qu’il y avait tout un tas de rumeurs, les gens s’inventaient des histoires, et ces histoires évoluaient avec le temps et au fur et à mesure que les gens les racontaient à nouveau. Je voulais réfléchir à ce qui se passait dans cet environnement, avec le contexte d’un site industriel en déclin, et regarder, essayer de comprendre ce qui arrive à la classe ouvrière. Cela m’intéressait d’explorer tout l’humour aussi, toute la passion, toute la chaleur qu’on trouve dans ces communautés, et qui sont souvent oubliées dans les représentations qui sont faites de la classe ouvrière, qui souvent sont faites par des auteurs qui n’appartiennent pas à la classe ouvrière. Je voulais donc retrouver cette chaleur, cet amour dans les rapports humains. Et ce qui m’intéressait aussi, c’était d’injecter dans tout ça un peu de bizarre, d’aller expérimenter un peu d’autres genres à partir de ça.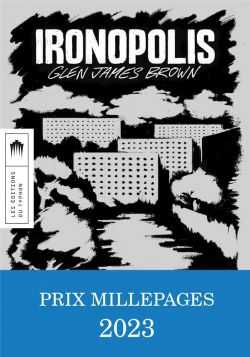
C. D. : David Joy, ce qui revient à travers tous vos livres, c’est la vie des habitants de votre comté aujourd’hui. Ceux qui sont restés, qui continuent à vivre là, avec une société qui a été ravagée par cette bulle immobilière et qui tentent de survivre…
David Joy : J’habite dans un endroit qui s’est énormément gentrifié, beaucoup de gens sont venus s’installer dans le paysage d’où je viens et où je vis, et il est devenu impossible pour les gens du coin d’accéder à la propriété. Et dans tous mes romans, c’est cela que je veux exprimer. J’ai entendu ce que les autres auteurs ont dit, et c’est vrai qu’une des raisons pour lesquelles un écrivain souhaite parler de la classe dont il est originaire dans ses romans, c’est parce que c’est porteur de conflit et la tension permet aux romans de fonctionner. Et c’est vrai qu’à mon sens, les problèmes au quotidien que les personnes aisées rencontrent ne sont pas porteuses de cette tension, qui permet aux romans de fonctionner. Je n’écris pas des livres avec des gens qui se demandent où ils vont passer leurs prochaines vacances ou des gens qui ouvrent le New York Times pour vérifier l’indice du Dow Jones. Moi, j’écris pour parler de gens qui se sentent acculés, qui sont acculés, des gens qui se demandent d’où va venir leur prochain repas. Parce que je pense que les personnages acculés deviennent réactionnaires. Et c’est un bon enjeu pour commencer un roman.
C. D. : Parlons justement de l’enjeu d’écrire un roman. Ce matin, nous discutions avec David Joy et vous disiez que dans une société où les gens n’arrivent pas à se parler les uns les autres, où les gens sont vraiment divisés, la littérature est une espèce de safe place où on peut prendre le temps de discuter, d’échanger, et ça permet aux gens de se poser des questions. Je trouve que cela résume très bien l’ensemble des romans des auteurs de cette discussion, cela résume vos points de vue, avec vos livres qui forcent le respect par le réalisme et la finesse des analyses tout comme ceux de vos personnages.
Alors pour vous, le roman est-il, comme le dit David Joy, une safe place pour expliquer, raconter ?
Sébastien Dulude : Oui, mais aussi pour amplifier. En fait, il y a une expression qui m’intéresse beaucoup, c’est celle de saisir l’occasion de la littérature. Donc on a une histoire à raconter, on veut un réalisme, on veut être juste, on veut être légitime dans notre perspective sur notre sujet, mais on a aussi une occasion de littérature. C’est l’occasion donc d’ajouter à l’histoire une expérience de texte, par le style, par la construction. Dans mon cas, j’avais envie de super-esthétiser le projet, justement pour ajouter cette espèce de filtre de couleur, un genre de lumière spéciale sur ce milieu-là. Peut-être le regard de l’enfance qui voit les choses avec une certaine magie, lorsque l’innocence est encore permise. Et cela permet de pouvoir créer ce contraste quand tout ça éclate. Dans la deuxième partie du roman, on retrouve le personnage principal sans son ami, et il voit tout à coup le monde de manière différente. Là on est un petit peu plus dans la confrontation directe, réaliste, des forces concrètes qui agissent ou qui empêchent le personnage. Mais dans tout ça, pour moi, c’est clair que l’écriture joue un rôle, c’est une voix qui est celle de la littérature qui n’appartient à aucun autre médium artistique.
Une des raisons pour lesquelles un écrivain souhaite parler de la classe dont il est originaire dans ses romans, c’est parce que c’est porteur de conflit et la tension permet aux romans de fonctionner.
David Joy
Michael Magee : Comme cela a déjà été dit, je crois qu’une grande partie de la littérature naît d’un conflit entre un individu et la société contemporaine. D’un conflit aussi avec les institutions politiques, le discours politique, qui reste souvent passablement obscur. Une part de l’entreprise consiste à domestiquer l’attente de l’oppresseur. Je crois vraiment que la littérature permet à beaucoup de lecteurs et de lectrices d’occuper un espace social qui autrement leur serait inconnu, voire inaccessible. Et je ne prétends pas que la lecture va permettre de changer une vie de manière radicale, en tout cas pas toujours. Mais il y a un réel impact, un effet qui pour moi a une grande valeur. Je pense que cela permet, au moins à certains, de formuler leur propre expérience et de se lancer dans cette confrontation du pouvoir, des défenses dominantes et de faire apparaître leur hypocrisie. Bien sûr, on sait que les inégalités sociales existent, que le racisme existe tout comme l’homophobie, la transphobie. Mais la littérature permet de formuler ces différentes consciences et ces différents conflits de manière particulièrement aboutie, et donc d’œuvrer en conscience.
Glen James Brown : Il y a eu pas mal de bonnes réponses, mais si je dois ajouter quelque chose, je dirai que personnellement, ce qui m’intéresse, c’est de représenter à chaque fois des voies très singulières au moyen de la langue, donc d’alterner, par exemple, avec différentes manières de s’exprimer, différents rythmes de parole, différentes langues, en expérimentant avec la typographie aussi, la mise en page du texte. Ce qui m’intéresse, c’est que toutes ces voies finalement très individuelles se fondent ensemble aussi. J’aime à la fois représenter des voies individuelles et voir comment tout cela va former un tableau plus vaste. Pour moi, c’est vraiment ce que peut faire la fiction, c’est à dire refléter des luttes plus vastes que les expériences individuelles, et voir que, comme on l’a dit, tous ces gens sont confrontés à des difficultés sociales, économiques, qu’ils sont opprimés du fait de leur identité et de ce qu’ils sont. Ces gens sont à la fois seuls face à ça, mais ils sont aussi ensemble, et ils vivent ces situations collectivement.
C. D. : David Joy, par rapport à ce qu’il vient d’être dit, l’écriture, ces voix seules dans ce collectif, je veux bien que vous nous racontiez comment vous arrivez à donner la parole, justement, à créer ces tous ces personnages. Parce que, si le propos est très juste, si vous collez aux personnages, nous ne sommes pas pour autant dans un documentaire, nous sommes dans la fiction, il y a toute cette puissance de l’écriture, comme le soulignait Sébastien Dulude, qui vient s’intercaler aussi par rapport au propos.
David Joy : Je passe beaucoup de temps à écouter. Nous vivons dans un monde où tout le monde se bat pour se faire entendre, pour parler plus fort que l’autre et on tend le micro à celui qui crie le plus fort. Nous vivons dans un monde où être sensible, ce n’est pas très sexy. J’ai toujours essayé dans ma vie de ralentir, de me taire et d’écouter. Ceci est dû à mon éducation. J’ai grandi dans un environnement où on attendait des enfants qu’ils soient discrets, qu’ils ne se fassent ni voir ni entendre. En gros, on devait rester assis et écouter. Et comme enfant, c’est vrai que c’était horrible, on avait envie d’aller dehors, de bouger. Mais aujourd’hui, en tant qu’adulte, je m’aperçois que c’était précieux. Quand j’écris, j’essaye d’enjamber des fossés. Dans mes romans, il y a des personnages féminins, de nombreux Noirs. Mais, moi, je suis un homme américain blanc, je suis en gros la catégorie la plus privilégiée sur cette terre. Et quand j’enjambe ces fossés, je suis en position dominante, et je veux en être conscient quand je fais entendre les voix de ce personnage. Il y a un écrivain qui s’appelle Alexander Chee et qui a beaucoup réfléchi sur cette question d’enjamber les fossés. Et il pose trois questions :
La première, c’est pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux franchir ce fossé ?
La deuxième, c’est combien de personnes connais-tu qui appartiennent à ces minorités que tu veux faire parler ? Par exemple, combien d’homosexuels connais-tu ?
Et la troisième question qu’il pose, et je n’avais jamais pensé à ça avant, est est-ce que tu as des livres de personnes de ces minorités dans ta bibliothèque ? Et donc, en écrivant ce livre, je me suis rapporté à d’autres auteurs, par exemple Ernest J. Gaines ou Crystal Wilkinson, et j’ai vraiment étudié ce qu’ils avaient couché sur le papier. Et c’est, vraiment, une façon d’habiter l’espace.
Que se passe-t-il quand un lieu comme celui-là est démantelé, décomposé par des forces extérieures ? […] Et, surtout, que devient cette histoire commune et collective que les gens partagent en un même lieu ?
Glen James Brown
C. D. : Justement, en parlant d’enjamber un fossé et de ces trois règles, pour ces premiers romans, avez-vous été dans ces questionnements ?
Michael Magee : Oh (sourires) ! Mon idée était de représenter l’expérience d’une génération qui est née à la fin d’un conflit qui a duré trente ans. Conflit au cœur duquel se trouvait Belfast. Les parents de Sean, en revanche, étaient directement impliqués dans ce conflit. Et tous les traumatismes qu’ils ont vécus ont été transmis à leurs enfants. Donc l’un des fossés que je voulais franchir ici, c’est ce fossé entre les générations. C’est vraiment le sujet principal du livre, sans doute. Et je voulais voir la manière dont ses conséquences indirectes façonnent les modes de vie, les questionnements de cette deuxième génération, pourrait-on dire. La mère de Sean, par exemple, est née au début du conflit. Elle l’a vécu dans son intégralité. Elle a perdu des amis, des parents, elle s’est retrouvée enceinte à dix-sept ans, puis elle s’est mariée. Et son exemple est singulier. C’est une espèce de condensé d’images, une galerie de portraits beaucoup plus ample. Et il semble qu’il y ait un abîme, un fossé infranchissable entre la mère et son fils. Et ce fils, cette deuxième génération, que lui reste-t-il ? Il hérite de ce trauma. Comment peut-il interagir avec ses semblables ? Comment peut-il trouver son chemin parmi les hommes de sa génération ? Comment peuvent-ils vivre tous avec ce nuage extrêmement pesant sur leurs épaules, sur leurs pensées ? J’explore dans ce roman cette zone du conflit et du conflit hérité. Mais il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de plaisanteries dans ce livre. Et c’est sans doute une image représentative, une image adéquate pour représenter une quête artistique, une quête de beauté, en un lieu où on nous a dit très tôt que la beauté n’existait pas. Et bien sûr, cette quête a d’innombrables enjeux esthétiques, mais aussi politiques.
C. D. : Que ce les parents de Sean ou les gens autour de lui, certains ont probablement participé au conflit, mais personne n’en parle. Vous prenez un exemple très fort, c’est celui du taxi. On voit Sean prendre un taxi, et Sean se dit, le chauffeur a cinquante ans, ça se trouve, c’était un tueur de l’IRA. Mais on ne sait pas et cela bloque encore plus au niveau de sa génération. C’est vraiment très important dans leur vie.
Michael Magee : Pour cette question du silence, forcément, quand on a vécu de telles atrocités, on ne peut pas tenir de long discours à ce sujet. Vous avez mentionné le chauffeur de taxi noir. Mais ma mère, par exemple – enfin, je veux dire la mère de Sean (sourire) – ne pense même pas que cela soit utile de parler de ces traumatismes. Elle ne croit pas qu’on puisse apprendre de ces horreurs, que cela puisse servir aux générations suivantes. Il y a aussi tout un appareil, dans l’ensemble des mécanismes sociaux et politiques britanniques qui se sont appliqués à passer sous silence les atrocités qui ont été commises. Que ce soit une fillette de douze ans abattue dans la rue quand elle jouait ou un prêtre abattu lui aussi alors qu’il cherchait à offrir les derniers sacrements à une victime. Je crois qu’il faut poursuivre cette lutte contre les siens et faire connaître toutes ces tueries injustifiées, gratuites. Mais, évidemment, et c’est sans doute le cas de tout trauma collectif, il y a une grande tension, violente elle aussi, entre une inspiration à vivre, donc à se taire, à ne plus parler de ces violences, et puis un besoin croissant de justement chercher à combler ces abîmes, de poser des questions, d’en parler. Et évidemment, tout ceci a un prix. Est-ce que cela vaut la peine ? Je pense que oui. Aussi bien pour les individus que pour les communautés.
Je crois vraiment que la littérature permet à beaucoup de lecteurs et de lectrices d’occuper un espace social qui autrement leur serait inconnu, voire inaccessible.
Michael Magee
C. D. : Glen James Brown, alors, à propos de ces fossés qu’on cherche à combler…
Glen James Brown : Ce que j’ai considéré pour cette histoire, c’est plutôt ce qu’il se passe quand ces fossés ne sont pas traversés, quand il n’y a pas de ponts qui sont construits à travers eux. Je suis aussi parti du folklore, des mythes urbains, parce que, finalement, dans tous les lieux, quels qu’ils soient, il y a des légendes urbaines qui circulent, des histoires de personnes, de créatures, qui vivent dans les bois ou, en l’occurrence, dans ce roman, l’histoire d’une femme qui vit dans une rivière. Cette femme qui vit dans la rivière, je l’ai introduite dans un récit qui était à la base un récit de réalisme social. Je l’ai mise pour essayer de voir ce qui se passe lorsqu’on introduit du folklore dans ces environnements-là. Le folklore finalement c’est quelque chose qui existe, parce qu’il est transmis de génération en génération entre les gens qui vivent dans un même lieu. Donc que se passe-t-il quand un lieu comme celui-là est démantelé, décomposé par des forces extérieures ? Que devient le folklore ? Que devient la femme dans la rivière ? Et, surtout, que devient cette histoire commune et collective que les gens partagent en un même lieu ?
C. D. : Michael Magee a dit tout à l’heure qu’avec l’écriture, on cherche à mettre de la lumière et de la beauté dans des lieux où elle n’existe pas. Il me semble que c’est exactement le projet d’Amiante. Dans ce lieu absolument effroyable, derrière, il y a une beauté, une lumière…
Sébastien Dulude : Oui. C’est à la fois un exercice cruel parce que, comme David le mentionnait, il n’y a pas de romance sans tension. C’est un roman sur l’expérience de la terre. Il fallait donc créer une situation initiale qui est magnifique, qui est en fait celle de l’innocence, une amitié de garçons avant que les normes sociales ne se mettent à juger comment se comporter, et de pouvoir vraiment explorer cet âge magnifique où l’innocence ce n’est pas un regard par-dessus soi, mais c’est vécu de l’intérieur. En fait c’est un âge où on ne se pose pas certaines questions, on ne se met pas dans certaines catégories, on exprime amour ou amitié de la manière qu’on l’entend. Donc si ces enfants ont envie de se réfugier, de se créer une cabane dans les bois, de faire une sieste, ils le font. C’est un moment qu’on doit chérir et on doit permettre aux enfants de pouvoir exprimer ça. Et après, par cruauté, il faut faire exploser cette situation-là pour voir ce qu’il en reste. Ce que cette lumière initiale a généré dans le roman, c’est la métaphore du feu. Mon personnage, à l’adolescence, ne sait plus où diriger ce feu qui l’anime. Et par métaphore, il est pris dans une ville qui ne brûle pas, une ville qui éteint tout. Alors, la seule lumière qui lui reste, c’est peut-être le ciel, comme voie symbolique de sortie. Mais encore là, dans le ciel, aussi bleu soit-il, il y a quand même des fusées qui explosent – on a la fusée Challenger, par exemple, qui a vraiment marqué l’imaginaire de ma génération. Donc cette lumière-là, il y a toujours son contraire. Une espèce de pulsation constante, d’oscillation constante entre les deux. Mais je suis assez content qu’on remarque la lumière de ce roman, plutôt que sa noirceur. Même si c’est quand même un roman où beaucoup de gens meurent.
C. D. : Oui, dans votre livre, la lumière est là parce qu’elle est portée par une plume magnifique. David Joy, par rapport à ce que disait Glen James Brown, j’ai l’impression qu’on était au cœur de votre dernier roman, quand il parlait de folklore qui est transmis de génération en génération. Vous, ce n’est pas du folklore, mais à travers ce roman, vous interrogez le poids de l’histoire, le poids de l’enseignement. Un des protagonistes dit « Ces gars lisent pas. La seule histoire qu’ils connaissent, c’est celle que leur a raconté leur papa, qui connaît lui-même que les conneries que son papa lui a racontées. » Et vous, vous explorez ce gouffre qui s’ouvre dans la montagne et dans la société, ce que résume cette phrase : « Du jour au lendemain un fossé se creusa dans le comté et coupa la montagne en deux. »
David Joy : C’est difficile d’essayer d’expliquer le conflit d’identité et ce qu’est d’être né aujourd’hui dans le sud des États-Unis. Je suis le représentant de la douzième génération de personnes de Caroline du Nord. Mes premiers ancêtres sont allés en Caroline du Nord au début des années 1600. Et moi, je peux dire que je suis donc le douzième représentant de la douzième génération blanche aux États-Unis. Et cela implique que je suis descendant d’esclavagistes. Grandir dans le Sud, c’est grandir avec cette histoire de la guerre civile, de la Confédération, et ceci a créé le conflit qui alimente mon roman. J’ai grandi avec un système éducatif dans lequel on m’a appris que la guerre civile n’avait rien à voir avec l’esclavagisme. À mes parents, on a appris que la guerre civile n’avait rien à voir avec l’esclavage. Et à leurs parents, on a appris la même chose. Et pendant ce temps, en 1861, le vice-président de la Confédération, Alexander Stephens, a fait un discours qui est assez célèbre, le Cornerstone Speech, « le discours de la pierre angulaire », dans lequel il expliquait que le nègre n’était pas égal à l’homme blanc et que l’esclavage était sa condition naturelle. Et 150 ans plus tard, c’est vraiment difficile de croire que la guerre civile n’avait rien à voir avec l’esclavage. Et le problème dans cette éducation, quand elle est systémique et multigénérationnelle, quand elle se transmet de génération en génération, c’est qu’elle construit les fondements de la compréhension du monde. Et que des années plus tard, c’est vraiment difficile de remettre ça en question. Pour ces gens, c’est comme si on leur disait que deux plus deux font cinq.
C. D. : Ce qui est extrêmement intéressant, c’est que dans tous vos romans, il y a une thématique qui revient chez vos protagonistes, c’est que pour eux, l’idée d’une vie meilleure repose sur un ailleurs. Il y a cette idée un peu fugace de « Si on partait, ça serait mieux ». Par exemple, pour vous, Michael Magee, c’est le départ en Australie. Quelle est cette notion de fuite, de terre hypothétique ailleurs qui serait meilleure ?
Michael Magee : Oui, on dit toujours que l’herbe est plus verte à côté. C’est difficile d’accepter cette idée, qu’on est né dans un environnement social, familial, que l’on n’a pas choisi, et qui, malgré tout, comme le disait David, nous façonne intégralement en tant qu’individu, dans nos interactions, dans nos modes de vie. Cette tentation de s’enfuir, dans le cadre de Sean, est motivée par un désir de fuir son passé, un désir de fuir une figure de père aussi, particulièrement violente à plusieurs égards. Donc fuir ses racines. Mais cette fuite signifie aussi trahir ce que l’on est, trahir ses origines. C’est toujours aussi d’une grande violence. Il est particulièrement difficile de chercher à démêler ce qui relève de ce qu’on est et ce qui relève de ce qu’on aspire à être. Et cette tension est toujours source de malaise. Dans le roman, finalement, la porte s’entrouvre pour Sean. Il se trouve face à cette possibilité de partir. Il ne franchit pas complètement le pas, il a vu que c’était possible, et il lui reste à confronter ce renoncement nécessaire à une part de soi s’il veut accéder à cet autre mode de vie. Le fait d’être à l’université a élargi son regard, l’a ouvert à d’autres points de vue. Mais, là aussi, basculer complètement, franchir le pas, veut dire aussi accepter le sentiment de la perte.
J’écris pour parler de gens qui se sentent acculés, qui sont acculés, des gens qui se demandent d’où va venir leur prochain repas. Parce que je pense que les personnages acculés deviennent réactionnaires. Et c’est un bon enjeu pour commencer un roman.
David Joy
C. D. : Glen James Brown, il y a un de vos personnages qui part à Londres et qui ne souhaite absolument plus rentrer à Ironopolis. On retrouve ce dualisme entre ce qu’on est, où on est, et ce qu’on aspire à être.
Glen James Brown : Oui, il part à Londres. C’est cette période rêvée, les années 1980. Il se passionne pour ça, mais il doit repartir d’où il vient et il s’aperçoit qu’il ne peut plus vivre comme ça. Je trouve qu’il y a quelque chose de très puissant dans l’idée qu’on s’en va de chez soi, on se sent vivre à fond, et d’un seul coup, on va retourner à son point de départ. Et plus largement, on voit ce phénomène dans le livre : des personnages qui partent pour essayer de trouver un avenir meilleur, qui leur a été promis dans des campagnes, avenir qu’on leur a fait miroiter. Et il s’avère que cet avenir qui leur a été promis n’est pas accessible à tout le monde. Et ça m’intéressait de voir toute cette tension entre ce à quoi les gens aspirent et ce qu’ils trouvent dans la réalité. Et ça, c’est quelque chose qu’on peut trouver dans toutes sortes de communautés différentes.
C. D. : David Joy, pour ceux qui sont attachés à leur comté, par leurs racines familiales, par cet environnement qui leur est proche, qui leur est propre, y a-t-il également l’idée de fuite pour se renouveler, se faire, se refaire ailleurs ?
David Joy : L’idée de s’échapper, il me semble, est particulièrement liée à l’identité rurale. Si on nait à a campagne, on rêve toujours d’être né à Paris (sourire), si on grandit d’où je viens, on rêve aussi de quitter cet endroit. Car on vit dans quelque chose qui est tellement petit, tellement confiné, où l’on connaît tout le monde, que chacun fait partie de ta famille, que le monde te semble si vaste ailleurs que tu n’as qu’une idée, en gros, c’est partir. Pour moi, c’est vraiment lié à l’identité rurale. Le plus grand conflit qui apparaît, c’est que tu veux t’échapper. Mais en fait, le monde d’où tu viens est essentiel à la construction de ton identité. Et c’est vrai, en particulier avec les personnages les plus âgés de mes romans. Je pense à Vess dans ce roman, ou à Ray dans Nos vies en flammes. Et ces personnages les plus âgés, en fait, ce qui les blesse, c’est de regarder l’endroit d’où ils viennent se désintégrer. Et c’est le sol même sur lequel ils se tiennent, qui se désintègre.
Merci au festival America et à Guillemette Monge-Romero qui a traduit les propos de David Joy, Valentine Leys-Legoupil ceux de Glen James Brown et Anne-Laure Tissut ceux de Michael Magee.
Pour aller plus loin
Le roman Amiante de Sébastien Dulude est publié par La Peuplade
Retour à Belfast de Michael Magee (trad. Paul Matthieu) est publié chez Albin Michel
Glen James Brown, avec Ironopolis (trad. Claire Charrier), est publié par les éditions du Typhon
Le dernier roman de David Joy, Les Deux Visages du monde (trad. Jean-Yves Cotte), est à retrouver chez Sonatine. Ses précédents romans sont parus en poche chez 10/18.
Toute la programmation du Festival America 2024.