Nous avons rencontré Xavier Boissel au festival Lire en Poche 2025 de Gradignan. L’occasion pour nous de revenir sur Avant l’aube, Sommeil de cendres et Fonds noirs, ses trois polars publiés chez 10/18.
Trois romans et un style
Milieu Hostile : Vos trois romans couvrent la période 1966-1986, époque charnière à vos yeux, pourquoi ?
Xavier Boissel : Il m’a semblé que cette séquence (comme on dit) historique de vingt ans est une période clé de notre histoire récente, que je considère un peu comme la matrice de ce qui nous arrive aujourd’hui. Le premier volet de ce triptyque, situé juste avant Mai 68, décrit une société encore compartimentée et sclérosée avec les germes d’une contestation, le deuxième se déroule au moment de l’agonie du président Pompidou, de l’élection de Giscard et sa promotion de la « société libérale avancée » (tandis que se consument les derniers feux du gauchisme), le troisième en 1986, juste avant la défaite du parti socialiste aux élections législatives de mars, au moment de la signature de l’acte unique européen (en février).
Que s’est-il passé durant cette période ? Des bouleversements bien entendu, mais dont on ne mesure pas toujours, je crois, les effets ni l’ampleur : liquidation des vieux partis politiques (gaullisme, PCF), crise économique structurelle, mutations culturelle et anthropologique, etc. Nous sommes entrés dans l’ère du capitalisme tardif, dont il n’est pas difficile de dessiner les contours : ceux d’un champ de ruines. Tout à coup, il nous est apparu qu’il était loin, ce temps où les situationnistes pouvaient crier haut que « la vie ne cesse d’attendre le moment de sa contre-offensive ». Ceux qui étaient partis à l’assaut du ciel dans les années 1960 ont perdu. Le capital a gagné : « la rugueuse réalité à étreindre, c’est que nous avons vraiment été vaincus », comme l’écrivait le regretté Bertrand Delcour (paraphrasant Rimbaud). C’est bien durant ces deux décennies que s’est jouée une certaine défaite du négatif. Le recyclage du gauchisme dans l’appareil d’État mitterrandien et l’assomption de ce que Rorty a appelé « la gauche culturelle » a parachevé le mouvement.
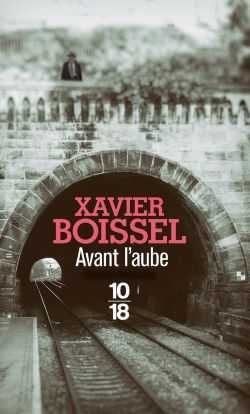
Depuis les années 1990, nous sommes dans une période de stase, de coup d’arrêt. Non pas un temps post-historique comme le comprenait Kojève, mais un temps dans lequel il est difficile de se projeter dans des protentions collectives, un temps spatialisé. Tout cela ne vient pas de nulle part. À l’évidence, nous sommes orphelins. La mélancolie de gauche, au sens où l’entendait Walter Benjamin en 1931, est généralisée, elle contemple ses propres ruines idéologiques jusqu’à transformer sa défaite en spectacle. Je pense qu’il faudrait lui opposer un autre type de mélancolie, une mélancolie « hantologique », idée très marquante dans les écrits de Mark Fisher (qui l’emprunte à Derrida). Qu’est-ce qui nous revient aujourd’hui sous forme de spectre ? C’est la question que pose Fisher. L’un des objectifs de ce triptyque, situé depuis les vaincus de l’histoire, est de mettre au jour les potentialités inaccomplies du passé, de nous projeter dans un temps qui ne serait plus continu, mais hétérogène. Je fais une littérature désenchantée, mais par ailleurs spectrale. C’est le sens des dernières lignes de Fonds noirs.
On ne peut pas dire qu’ils forment une trilogie, mais ils sont finement liés par des références à différents enquêteurs – mais c’est loin d’être une série. « De simples rouages d’un truc qui les dépassait le plus souvent, des rouages bien lubrifiés, mais usés avec l’âge », comme le dit un des protagonistes.
Pourquoi ce besoin de liens ?
Oui, ce n’est pas tout à fait une trilogie et je voulais surtout éviter la sérialité, qui me semble être un piège, surtout commercial. On peut lire ces trois romans de manière totalement disjointe, comme s’ils étaient des one shots. Pour autant, il y a bien évidemment des liens entre les trois, d’abord à la manière de Balzac, puisque je joue sur le ressort très classique du retour de certains personnages. Mais il y a aussi des liens plus souterrains avec ces trois figures de flic. Sur le plan technique, on pourrait dire que chacun des trois romans est écrit du « point de vue de la police », comme le sont une majorité de polars français. Mais c’est plus compliqué : d’abord, parce que si Marlin, Éperlan et Wouters ne sont pas des salauds antipathiques et corrompus, ce ne sont pas pour autant des humanistes, ils ont chacun des angles morts et sont les premiers à faire des pas de côté avec la loi, montrant par là que l’ordre du droit peut être en contradiction avec lui-même. Mais surtout, parce qu’à la fin de chaque volet, le crime triomphe, en dépit de tout ce qu’ils ont pu faire. Donc finalement, quelles que soient leurs motivations, ils contribuent au maintien d’un ordre social et politique mauvais. À leur insu, ou parfois très consciemment – c’est le sens du passage, que vous citez – ils sont les courroies de transmission des rapports sociaux existants.
Nous sommes entrés dans l’ère du capitalisme tardif, dont il n’est pas difficile de dessiner les contours : ceux d’un champ de ruines.
Vous nous avez dit avoir été inspiré par la Trilogie underworld, de James Ellroy, mais, dans le rendu, on est loin du style et du découpage, pourriez-vous nous en dire quelques mots ?
Absolument. La lecture de cette trilogie a été un choc. J’avais été fasciné par la façon dont Ellroy travaillait le matériau historique. J’avais vraiment ce sentiment qu’il renouait avec la grande entreprise de Balzac : investiguer « l’envers de l’histoire contemporaine », mais sur un mode et un rythme bien évidemment beaucoup plus frénétique, chaotique même. Ce que j’avais trouvé très fort avec cette trilogie, c’est que l’on pouvait en faire comme pour Balzac une double lecture, une lecture conspirative, avec cette idée que le monde social et le monde politique sont gouvernés par des petits groupes d’hommes dans l’ombre qui font jouer le jeu de leurs ambitions et de leurs passions et une lecture plus proche de celle de Lukács, insistant sur le fait que ces hommes ne sont qu’un produit de forces sociales que leur destinée permet d’explorer en profondeur. Je m’étais alors dit qu’en France, nous aussi avions un tel matériaux historique, avec le fonctionnement mafieux de notre appareil d’État, sa violence et sa corruption. J’avais été frappé que très peu d’auteurs de polar se fussent intéressés par exemple au SAC (le Service d’action civique, qui occupe les deux premiers volets) ou de manière secondaire, voire adventice chez des auteurs comme Didier Daeninckx ou Dominique Manotti. Depuis, quelques écrivains français se sont à leur tour inscrits dans cette veine, je songe par exemple aux romans de Thomas Cantaloube, Frédéric Paulin ou Benjamin Dierstein, dont la dernière trilogie se met totalement dans les pas de celle d’Ellroy.
Explorer les coulisses de l’Histoire – en l’occurrence les égouts de la Ve République –, tenter de mieux saisir la violence des rapports sociaux, voilà en quoi Ellroy m’a influencé. Mais ensuite, mon projet est d’un tout autre ordre et il diffère radicalement aussi bien dans le découpage que dans le style, comme vous le relevez très justement.
À lire aussi : 5 raisons de… Benjamin Dierstein : Bleus, Blancs, Rouges
Question style, aussi, on est loin du style syncopé de James Ellroy, on remarque votre plume élégante… Comment travaillez-vous ça ?
Il est vrai que l’on est loin du hachoir à phrases d’Ellroy. La question du style est centrale et même épineuse pour moi. Je ne l’entends pas dans un sens réactionnaire, disons que je me reconnaîtrais plutôt dans la définition qu’en donne Flaubert : « une manière absolue de voir les choses » et de ce que j’en ai compris. Je ne cherche pas à écrire dans une forme de grand style à la française, un style « Belles-Lettres », compassé et vitrifié. Beaucoup d’écrivains français aujourd’hui consacrés s’illustrent à merveille dans ce registre, leurs textes « font signe vers la littérature », pour reprendre une formule de Barthes. Ce n’est pas du tout ce que je cherche à faire. De manière symétrique, je n’aime pas non plus le débraillé stylistique, qui, au-delà de sa posture, m’a toujours exaspéré par sa complaisance. Que ce soit par le haut ou par le bas, j’ai l’impression que nous assistons à une kitschisation de la littérature française. Le travail du style pour moi correspond au travail de la forme, car depuis mes jeunes années, je suis persuadé que c’est la forme qui engage le fond. S’il y a un engagement, c’est dans la forme avant tout. C’est un rapport au monde qui peut être parfois poétique, un travail dans le langage lui-même.
Mais ce n’est pas non plus un simple jeu « formel ». La forme est aussi la sédimentation d’un contenu qui est d’abord social. Manchette se plaisait à citer fréquemment une formule adaptée à son genre de prédilection : « La forme du polar est bien la forme de son contenu », formule pétrie d’hégéliano-marxisme : la forme est l’expression nécessaire, historique et déterminée de son contenu. C’est bien ce que s’est efforcé de démontrer Marx en articulant sans cesse forme et contenu dans son analyse des catégories économiques et sa critique de l’économie classique qui traite les formes économiques (valeur, capital, salaire) comme des choses « en soi » alors qu’elles sont des formes historiques déterminées de leur contenu social (travail, rapports de production). La forme n’est pas un « emballage » neutre : elle exprime, révèle et structure son contenu. Je ne vois pas en quoi le langage et en particulier l’écriture pourraient échapper à cela, « les mots travaillent » pour reprendre le constat des situs. Il y a bien une homologie entre économie et symbolique, comme l’ont montré les travaux de Jean-Joseph Goux. C’est pourquoi c’est à la forme elle-même, à sa matérialité, qu’il faut s’attaquer, sans être pour autant formaliste ni postmoderne, bien sûr. Je me considère donc comme un artisan qui peaufine son objet.
Et, pour finir sur le style, il y a aussi les nombreuses citations qui parsèment vos romans. Comme vous l’écrivez « Les citations dans mon travail sont comme les brigands sur la route, qui surgissent tout armés et dépouillent le flâneur de sa conviction » (Walter Benjamin). D’où est venue cette idée ? Et comment collectionnez-vous – si on peut appeler ça comme ça – ces phrases dont vous vous servez ensuite ?
Je suis depuis longtemps lecteur de Benjamin. J’aime beaucoup cette citation qui provient de « l’avis au lecteur » qui ouvre Sens unique. J’aime cette idée que les citations travaillent souterrainement le texte. Je les reproduis parfois telles quelles, parfois je les détourne (ça c’est l’héritage situ). Cette pratique est très présente chez les prosateurs français, comme Proust ou Céline, elle est même récurrente chez Perec. Ces fragments empruntés à d’autres auteurs sont en embuscade, ils surgissent là où on ne les attend pas et viennent dérégler le texte, le fait de les intégrer dans un autre texte, permet de leur donner un autre relief, un autre sens, une autre perspective. Cela fait vaciller le sujet d’énonciation et détruit l’illusion d’une maîtrise du sens. Dépouiller le flâneur, c’est désarçonner le lecteur, mais aussi l’auteur. C’est une manière d’abdiquer certaines prétentions auctoriales, celle du « grantécrivain », pour reprendre le néologisme ironique formé par Dominique Noguez : la figure française par excellence, que j’exècre. C’est enfin une façon pour moi de dire que je ne viens pas de nulle part, que je suis traversé par d’autres. C’est d’ailleurs le sens du vers d’Apollinaire mis en exergue dans l’un des chapitres de Fonds noirs (« Mais nos pieds ne se détachent qu’en vain du sol qui contient les morts »). C’est l’idée que l’on hérite toujours des morts, de la tradition, de toutes les générations mortes comme l’écrivait Marx, pour qui le passé est un poids mort qui freine la nouveauté, idée retournée dialectiquement par Benjamin dans ses Thèses sur le concept d’histoire (« Le passé porte en lui un index secret qui le renvoie à la rédemption »). J’écris, mais je lis aussi beaucoup. C’est au fil de mes lectures que je collecte ces emprunts, je les note dans un carnet et les laisse dans un coin de ma petite tête. Là encore, c’est une manière spectrale de faire de la littérature.
Ces fragments empruntés à d’autres auteurs sont en embuscade, ils surgissent là où on ne les attend pas et viennent dérégler le texte.
En octobre dernier, vous interveniez à la BNF lors d’un colloque consacré à Jean-Patrick Manchette, quel est votre rapport à son œuvre ?
Jean-Patrick Manchette est un peu devenu aujourd’hui la statue du commandeur du polar français, le « grantécrivain » dont je viens de parler, je ne suis pas certain que cela lui aurait plu. Son poids peut paraître pour certains écrasant. Il est à la fois une référence majeure et il en agace plus d’un. Certains pour de mauvaises raisons, qui sont liées au ressentiment, d’autres pour des raisons qui sont liées à une forme de malentendu depuis que l’expression « néo-polar » a fait florès, malentendu qui perdure encore aujourd’hui dans une époque où le polar dit « politique » peut paraître peut-être plus désabusé. On dit souvent que les romans de Manchette ont illustré l’intrusion fracassante du gauchisme dans le polar, qu’il l’a politisé, or cela n’a rien à voir. On m’associe souvent aux écrivains qui font du polar politico-historique – ceux dont j’ai parlé tantôt – en disant qu’ils sont des héritiers ou des continuateurs de Manchette. Je pense que la généalogie de cette branche a plus à voir avec Didier Daeninckx qu’avec Manchette. L’héritage est donc lourd et inhibant, mais pour ma part, je l’assume ouvertement : c’est un auteur dont je me sens sans cesse débiteur. D’une part, parce que je l’ai découvert jeune et que c’est grâce à lui que je suis entré dans le genre, comme Ballard et Brussolo m’ont fait entrer durant mon adolescence dans la science-fiction et Lovecraft dans le fantastique. D’autre part, car il m’a fait comprendre – avec d’autres – qu’il était vain de vouloir opposer des contenus antagonistes – c’était le sens même du geste de la modernité – à l’autonomisation de l’industrie culturelle, qu’il ne s’agissait pas de rejeter cet appareil mais d’entrer dans son « jeu dangereux », en passant « derrière les lignes ennemies ». C’est la critique d’Adorno par Enzensberger qui m’a permis de saisir cela théoriquement (le passage de « l’industrie culturelle » à « l’industrie de la conscience »), et pratiquement, c’est Manchette. Enfin, même si sur la question de la forme telle que je l’ai évoquée plus haut, je pourrais revendiquer aussi d’autres influences, j’admire bien évidemment le styliste, mais, aussi sa position humble et généreuse, très loin des postures aristocratiques de certains situs ou pro-situs.
Entrons maintenant dans vos différents romans.
Avant l’aube
Ce roman se passe en 1966. Ce qui frappe d’entrée de jeu, c’est la relation entre Marlin et Baynac, son supérieur, leur premier entretien et tout ce jeu sur l’ombre et la lumière – qui marquera leur relation dans le livre – qui est tout aussi subtil qu’excellent. Comment avez-vous abordé ce passage, très cinématographique ?
La relation entre ces deux policiers est particulière, parce que ce sont deux anciens résistants. L’ainé, issu du groupe parisien « L’Honneur de la police », dont quasiment tous les membres ont été arrêtés et déportés et le plus jeune, ex-maquisard impétueux. C’est ça qui les réunit, alors qu’ils travaillent tous les deux pour une institution qui s’est massivement compromise sous l’Occupation. Ce sont des hommes issus de « l’Armée des ombres » et je voulais donc jouer sur ça aussi, sur cette fraternité nocturne. Mais il y a bien évidemment le contraste avec la lumière qui joue beaucoup, car Baynac est un homme qui a des angles morts – une part d’ombre – que Marlin découvrira dans la suite de l’enquête. C’est cette idée qu’on ne connaît jamais vraiment les gens, qu’ils nous sont opaques. D’emblée, je voulais dès leur première rencontre installer cette dialectique entre ombre et lumière. Le passage est complètement influencé par le cinéma en effet, pas forcément par des choses comme l’expressionnisme allemand, mais plutôt par une forme de réalisme que j’aime bien et qu’on retrouve dans le film noir américain, mais aussi dans un certain cinéma français, par exemple dans Le Corbeau d’Henri-Georges Clouzot.
Par petites touches, sans longues descriptions, vous brossez un excellent rendu du Paris de l’époque, comment avez-vous travaillé ces reconstitutions ?
Je me suis plongé dans une somme de documents plutôt conséquente, beaucoup de photographies. J’ai pas mal discuté avec des connaisseurs, des historiens amateurs mais aussi des personnes de mon entourage proche ayant vécu dans la capitale dans ces années-là… Mais j’ai surtout fait appel à mes souvenirs visuels, principalement ceux du cinéma. Paris est en effet très présent dans le cinéma français des années 1960 et comme j’ai une imagination plutôt visuelle, cela n’a pas été trop difficile.
On croise le SAC, les magouilles financières politiques – là c’est des terrains avec les projets autoroutiers… Et des restants de la guerre d’Algérie, Jacques Foccart en passant….
La guerre d’Algérie et la Françafrique sont les deux tâches aveugles de la France des années 1960, qui a tant aimé sa prospérité économique et s’y est lovée.
« Chaque homme définit son époque en secret »… une phrase leitmotiv de votre roman (je n’ai pas retrouvé la référence), qui résume parfaitement ce que peut être le polar, aussi, non ?
Oui, cette citation est tirée de l’autobiographie de Jean-Paul Sartre, Les Mots (1964). Elle apparaît dans la partie où Sartre évoque son enfance et sa relation à la littérature, soulignant comment chaque individu, même dans l’ombre, façonne inconsciemment le sens de son temps. Je n’aime pas beaucoup Sartre, mais je lui reconnais parfois une forme de génie de la formule fulgurante. Cette phrase est en effet parfaite pour définir le polar, dont d’ailleurs Sartre était très amateur (comme l’étaient aussi Benjamin ou Gramsci, ce qui est somme toute logique pour des marxistes).
Et à la fin, on peut lire des remerciements à Valentin Baillehache co-directeur de la collection Rivages/Noir, mais vous n’êtes pas pour autant publié chez Rivages…
À l’époque de l’écriture du roman (2015-2017), c’est Valentin Baillehache qui s’occupait de la collection « Grands détectives », qui n’existe plus. C’est lui qui m’a fait venir chez 10-18 et je lui suis à cet égard infiniment redevable. Mon prochain roman – un truc hybride entre le roman noir et le roman d’espionnage – paraîtra d’ailleurs chez Rivages/Noir en 2027, si j’avance bien.
Sommeil de cendres
On a parlé des citations plus haut, mais là, ce n’est pas tous les jours qu’on cite Witold Gombrowicz dans un polar… « le silence de leurs corps était absolu »… On sent l’agrégé…
C’est un écrivain que j’ai découvert jeune, en classes préparatoires et dont j’aime beaucoup la causticité.

Dans ce deuxième roman, qui se passe en 1974, on croise aussi le SAC qui convoie de la cocaïne depuis le Maroc, qui noyaute les services de police, qui collecte des fonds occultes, a des rapports avec le grand banditisme…
Oui. C’est une époque où le SAC commence à être fragilisé, parce que Pompidou a soupçonné beaucoup de barbouzes d’être derrière l’affaire Marković. Donc il a coupé les vivres, il fallait trouver de l’argent ailleurs. Mais le SAC est encore très présent dans la police et ses liens avec la pègre sont très solides, depuis le début des années 1960, lorsque l’on a recruté un peu n’importe qui pour liquider les partisans de l’OAS.
On parle aussi des cercles de jeu, avec leur statut fiscal si à part à l’époque…
Tout à fait, les cercles de jeux étaient assujettis à un régime fiscal beaucoup plus léger que celui des casinos. Leur statut fiscal était marqué par une ambiguïté structurelle, hérité de la loi de 1901 sur les associations à but non lucratif, qui contrastait avec leur activité lucrative réelle. Cette fiscalité légère, couplée à un contrôle policier accru, visait à prévenir la fraude, mais des affaires de blanchiment et de liens avec le banditisme émergeaient déjà. Elle n’a été réformée qu’en 2018, c’est donc très récent…
« Eperlan était, depuis ses années de formation, convaincu que tout, dans une histoire de crime, était affaire de perception, et non de méthode »… ne serait-ce pas votre postulat comme écrivain ? Même si on sent la méthode, car toutes les portes ouvertes dans le roman sont refermées, rien n’est gratuit…
Je n’avais pas pensé que cette phrase pourrait avoir aussi ce sens et je suis très sensible au fait que vous l’ayez relevé. Comme quoi, rien n’est jamais totalement maîtrisé avec l’écriture, que la multiplicité du sens échappe même à son auteur, c’est bienheureux.
Je m’applique en effet à être méthodique et faire en sorte que le lecteur ait des réponses aux questions qu’il se pose. Cela fait partie du « contrat » : un bon polar doit être aussi divertissant, le lecteur doit en avoir aussi pour son argent, cela participe du plaisir de lecture. Je n’aime pas cette mode d’aujourd’hui d’une littérature « déceptive », avec ses fins ouvertes. Le polar est une littérature de plaisir, j’insiste sur ce point, qui n’est pas négligeable. J’assume d’ailleurs totalement ce plaisir, qui n’est plus de surcroît coupable comme il le fut auparavant, ce qui fait qu’il n’y a aucune raison de chercher à le justifier par une sorte de vernis littéraire ou intellectuel. Au surplus, le polar est bien évidemment sorti de son ghetto : cela fait belle lurette qu’il n’est plus un « mauvais genre », que l’on a longtemps opposé à la littérature dite « légitime » (désintéressée et non-commerciale – nous rions), qu’il est intégré à la culture, à la politique, au marché (ces mots sont désormais synonymes), reconnu par l’université, accaparé par le discours officiel, parfaitement soluble dans l’eau tiède du néo-libéralisme etc. S’il ne faut pas se faire beaucoup d’illusions – a fortiori en France – sur la potentielle subversion du genre, il ne s’agit pas pour autant de chercher à le légitimer ou à l’embourgeoiser, ce qui serait absurde, dans la mesure où ces catégories bourdieusiennes sont brouillées, voire obsolètes à l’ère du capitalisme tardif. Disons que l’idéal pour moi serait de pouvoir combiner texte de plaisir et texte de jouissance, pour reprendre l’opposition établie par Barthes : d’un côté, écrire des romans qui procurent un plaisir confortable, accessible, immédiat, et de l’autre, qui provoquent un trouble chez le lecteur, qui le désarçonnent comme je l’ai dit par exemple avec le jeu des citations. Petite précision nonobstant : il n’y a aucune hiérarchie entre ces deux niveaux de lecture à mes yeux, ils sont superposables, l’essentiel est que tout cela se fasse par-dessus le marché. J’espère avoir réussi mon coup avec ce triptyque plein de fantômes.
Et puis, c’est l’époque, on fume… et là, comme ailleurs, il y a cette minutieuse reconstitution, mais tout en douceur, les gens marqués par ce qu’il fume, ce qui nous a fait penser à la très belle plume de Hugues Pagan.
Il y a un lien étroit, je pense, entre le fait de fumer et le temps. Fumer est chez moi un acte qui fait vaciller la perception du temps lui-même, qui bouscule toute forme de spéculation : « Je savoure dans la cigarette le flottement de toutes pensées », écrit Pessoa (dans Bureau de tabac). Chaque cigarette fumée est toujours la même sans jamais être la même, exactement comme l’instant dans la Physique d’Aristote, à la fois le même, puisqu’il s’identifie avec un présent quelconque, et autre, puisqu’il dépend d’un contexte chaque fois différent. Le tabac dans mes romans intervient souvent dans des moments de pauses, ce sont des hiatus qui renvoient à un temps non linéaire, fractal, presque.
Je vous remercie de me parler de Hugues Pagan, pour lequel j’ai une certaine estime. Il appartient à la catégorie des très grands stylistes français, comme Richard Morgiève – qui n’écrit pas exclusivement des polars – pour lequel j’ai aussi une vive admiration. Ce sont de grands auteurs contemporains, aussi importants à mes yeux que des Américains comme James Sallis, Kent Anderson ou William Gay, que je vénère.
Fonds noirs
Avec ce dernier roman, c’est un grand bond historique, on arrive en 1986… fini la droite – même si ce sera l’année de la première cohabitation – on milite à l’UNEF, on croise des militants trotskistes et le PS. Mais nous sommes toujours dans les coulisses de l’histoire et vous nous parlez des ventes d’armes à l’Iran à l’époque sous embargo.
Ce troisième volet est de loin le plus autobiographique, c’est aussi le plus court, car je n’avais pas envie de trop m’épancher sur ma jeunesse. Quand j’étais lycéen au début des années quatre-vingt, la LCR et LO étaient encore implantés dans les établissements scolaires, cela restait marginal, mais ils étaient là. J’ai découvert le lambertisme plus tard, à la fac, car ils avaient noyauté l’UNEF. Mais je voyais bien déjà que tout cela était une comédie. C’est ce qu’avaient noté les gens de l’Encyclopédie des nuisances lors du mouvement de décembre 1986 : les étudiants tentaient de « refaire mécaniquement mai 68 », comme je le fais dire à mon personnage Éric, à la fin du roman. J’aurais bien aimé, moi aussi contester, mais je sentais que tout cela sonnait faux, que l’histoire commençait déjà à se parodier et à bégayer. Je percevais un tournant moral à gauche, avec ses prétentions vertueuses, alors, je préférais rester chez moi dans ma chambre, à fumer, à lire des romans édités dans la collection « Présence du futur » (dirigée par Élisabeth Gille, une immense éditrice) ou écouter des trucs comme Érik Satie ou Durutti Column. Ça, c’était ce que je constatais à hauteur d’homme

Mais par le haut, c’était bien pire : le cynisme était généralisé, le manœuvrier à la petite semaine Mitterrand m’inspirait un immense dégoût, égal à celui que m’inspirait la droite dite « décomplexée ». Quand a éclaté « l’affaire Luchaire », rien ne m’a surpris. La France vendait donc des armes à l’Iran, l’ennemi de son allié, l’Irak, faisant entorse à l’embargo européen et, cerise sur le gâteau, une partie de l’argent revenait sous forme de commission occulte dans les caisses du PS pour financer ses campagnes électorales. La gauche convertie à l’économie de marché sombrait dans l’affairisme. C’étaient « nos fantastiques années fric », pour reprendre le titre du beau roman de Dominique Manotti. J’ai vraiment haï ces années-là. Je me suis consolé bien plus tard en comprenant que je n’étais pas le seul en lisant La Décennie, le livre de François Cusset, qui fait un point très méthodique sur ce tournant idéologique qui nous a directement menés dans le marasme où nous sommes aujourd’hui.
Une année 1986 qui se terminera par la mort de Malik Oussekine.
Oui, avec les équipes de policiers voltigeurs de Pasqua, ex-figure du SAC, nouvelle preuve du continuum de la violence historique de cette double décennie. Malik Oussekine sortait d’un bar à jazz, il a tout de suite été repéré par les flics qui se sont déchaînés sur lui. Sans commentaire…
À lire aussi : Oussekine : l’histoire, politique et familiale
Ce roman est tout aussi parisien, mais, nous n’en avons pas encore parlé, nous voyons de nouveau des paysages de la Drôme, de l’Ardèche, dont vos descriptions sont magnifiques, « des paysages pacifiés » aviez-vous dit.
J’aime bien jouer sur ce contraste entre Paris et ce que l’on appelait auparavant « la province » et que l’on nomme aujourd’hui en langage techno-macronien « les territoires ». Il y a Paris, sa trépidation et puis le reste de la France, plus calme, notamment avec ses belles endormies. « Paris et le désert français », selon le titre d’un livre célèbre de géographie publié au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C’est quelque chose sur lequel je me suis déjà expliqué : cette fracture Paris/province traverse il me semble une bonne partie du corpus de la littérature noire française contemporaine. Je pense que ce n’est pas par hasard. En ville, vos sens et vos nerfs sont sans cesse sollicités. Je me réfère ici aux analyses de Georg Simmel : pour se protéger, l’individu doit adopter une attitude blasée. Mais paradoxalement, comme il le dit très bien, cette froideur et cet anonymat permettent une plus grande liberté personnelle par rapport aux contrôles communautaires traditionnels de la campagne. La ville est donc à la fois oppressante et libératrice. C’est la dialectique de l’urbain, avec cette tension permanente entre aliénation et émancipation. Et le polar est d’abord et avant tout un genre urbain par excellence (même si depuis quelques années on parle de « polar rural »). À la campagne, c’est exactement l’inverse. Surtout quand on évolue dans des paysages où il n’y a personne et c’est ça qui m’intéresse. D’un seul coup, on se retrouve seul, aspiré par le paysage. Cela peut être angoissant pour un citadin, mais cela peut permettre aussi une sorte d’échappée, de ne plus être pris dans cette tension dialectique. Dans le roman, cela se traduit en effet par des stases sur des moments pacifiés où la prose se déploie poétiquement. C’est une porte de sortie dans une langue presque minéralisée par le paysage… même si à la fin on revient toujours à la ville. Car en fait, je n’ai jamais aimé la campagne.
On a une bande son assez incroyable : Minimal Compact, The Jesus and Mary Chain (on évitera Death in june) – dire qu’on fête les 40 ans de Siglo XX en Belgique l’année prochaine. On joue au baby-foot, on achète ses vinyles chez New Rose … Serait-ce une part de votre jeunesse, par hasard ? – et merci de nous avoir fait découvrir cette reprise de Joy Division par Grace Jones…
Oui, comme je l’ai dit plus haut, c’est totalement autobiographique. Étant Lillois, je n’habitais pas très loin de la frontière belge et j’ai baigné dans l’atmosphère post-punk et cold wave. On évitera Death in June, cela vaut mieux en effet. Je suis heureux que vous fassiez allusion à Siglo XX, un groupe belge originaire d’une région minière en déshérence. La cold wave ne pouvait que surgir dans ce genre de paysage post-industriel (Manchester pour nos amis anglais) de même que la techno a pu surgir à Detroit, avec le label Metroplex. À Lille, le magasin où l’on pouvait trouver cette musique underground s’appelait La Boucherie moderne, lié au label indépendant Danceteria (qui avait produit les Berlinois d’Einstürzende Neubauten), il était juste à côté de la gare (celle qu’aujourd’hui on appelle Lille-Flandres, à l’époque il y en avait qu’une). Il y avait aussi Disco Smash, à Menin, en Belgique, tout à côté de la frontière. C’est une période où l’on ne trouvait pas la musique comme on peut la trouver aujourd’hui directement en accès libre sur Spotify ou Deezer. Il fallait fouiller, être curieux.
Je suis ravi de vous avoir fait découvrir la reprise de Grace Jones qui est en effet extraordinaire. J’ai beaucoup aimé ce moment où la musique punk a été télescopée par la musique noire, des Clash aux Specials en passant par A Certain Ratio. Mark Fisher – encore lui – met en lien ces expérimentations sonores avec L’Atlantique noire, l’essai de Paul Gilroy. Il précise d’ailleurs que la relation entre Joy Division et la pop noire a été occultée, alors que toute leur musique est imprégnée de funk, de dub, de disco ; mais de manière non littérale, à l’inverse de PIL, ça donne quelque chose d’abstrait, de presque conceptuel. La reprise de Grace Jones est merveilleuse car elle permet un aller-retour judicieux, une sorte de court-circuit temporel post-punk des plus bienvenus.
Pour aller plus loin
Xavier Boissel est l’auteur chez 10/18 d’Avant l’aube, Sommeil de cendres et Fonds noirs. On lui doit aussi des ouvrages chez Inculte.
