Après son diptyque basque, L’homme qui a vu l’homme et Au fer rouge, Marin Ledun revient avec un nouveau roman, En douce. Pour la sortie de celui-ci l’auteur nous a accordé un entretien, il nous parle de la construction de ce roman et de son personnage principal, mais aussi de son parcours d’écrivain, et réaffirme la nécessité de la littérature noire.
Alors, après dix ans de polar (plus ou moins) où en êtes-vous ? Quel regard portez-vous sur votre carrière ? Sur le monde du polar ? Et sur l’édition en général ? Et oui, on attaque fort…
J’ai commencé à écrire Marketing Viral au printemps 2005. Deux ans plus tard, je démissionnais du Centre national d’études de télécommunications, à Meylan, dans l’agglomération grenobloise, où je travaillais depuis 2000, entre recherches, vie militante, pollution et embouteillages. Me voilà aujourd’hui romancier à temps plein, une quinzaine de romans publiés, installé dans une baraque landaise, au milieu d’une forêt de chênes, de pins et d’acacias, un potager et un verger qui nourrissent toute une famille, de la corne sur la paume des mains, une consommation réduite au minimum, une hygiène de vie aussi bonne que possible, si l’on excepte un bilan carbone désastreux à cause des multiples déplacements que j’effectue pour rencontrer des lecteurs (sic !) : c’est à peu près tout ce que je retiens de ces dix dernières années passées à écrire, à vivre à un rythme moins dingue que celui des quinze années qui les ont précédées et à rencontrer et parfois lier de belles amitiés avec des 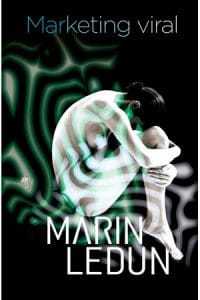 personnes aux parcours hétéroclites que je n’aurais probablement jamais croisées sans ce drôle de métier.
personnes aux parcours hétéroclites que je n’aurais probablement jamais croisées sans ce drôle de métier.
Bien sûr, nous sommes tous très inquiets des bouleversements récents qui agitent le milieu de la culture, réforme désastreuse de la retraite des auteurs, précarisation, baisse des subventions dans bon nombre de festivals, fermetures de librairies… Je crois qu’il est important d’avoir à l’esprit que nos romans sont une forme de résistance à tout cela. Toutes ces difficultés qui émergent depuis quelques années, et leur lot d’inquiétudes et de problèmes quotidiens concrets, ne doivent pas « parasiter » notre travail d’écriture – sinon, la bataille sera définitivement perdue. Que la littérature noire perdure, depuis des décennies, en dépit de ventes modestes – et ce, avec une constance qui devrait faire d’elle, avec les littératures romantiques, érotiques et des recettes pour maigrir, le bonheur des esprits comptables – et de son caractère subversif, me ravit au plus haut point. La faiblesse croissante des dotations publiques pour la culture, la paupérisation des auteurs, l’explosion du phénomène de « best-sellerisation » engendrant des écarts sans cesse croissants entre les meilleures ventes de romans et le commun des écrivains, la marketisation de l’édition, la prolifération des publications, les fâcheux de l’autofiction, célébrés en héros des temps modernes, la censure, la morosité ambiante, rien n’y fait : le « noir » continue, du fond de sa cave, de produire avec pugnacité des histoires qui surprennent, réinventent les codes littéraires et parlent du monde dans lequel nous vivons.
Mille fois, on nous a vendu la mort du genre, trop politique, trop engagé, trop ceci, pas assez cela, mille fois la littérature noire resurgit.
Des festivals se créent chaque année aux quatre coins de l’hexagone pour le célébrer, des journalistes littéraires lui consacrent des pages entières de chroniques dithyrambiques inversement proportionnelles à la réalité des chiffres de ventes, des lectrices et lecteurs enthousiastes se précipitent dans les librairies ou médiathèques qui ont le bon goût de le mettre en avant, d’autres créent des sites, des groupes Facebook, des blogs, parfois – souvent ! – d’excellente facture, pour le décortiquer et le mettre à l’honneur, des éditeurs de noir courageux et ambitieux tels que Gallmeister se lancent dans la jungle du « marché littéraire », souvent avec succès, des concours de nouvelles noires fleurissent, rejoignant les rangs de ceux qui existent depuis des années, envers et contre tous les pronostics qui font de la nouvelle, en France, un genre désuet, peu commercial et voué à l’échec, et j’en passe. Des romans noirs surgissent de nulle part, des auteurs jeunes ou à la carrière bien remplie, nous offrent des bijoux littéraires, comme Aux animaux, la guerre de Nicolas Mathieu, Le chemin s’arrêtera là, de Pascal Dessaint, Une plaie ouverte de Patrick Pécherot, Pukhtu de DOA ou encore Après la guerre de Hervé Le Corre. Des hommes et des femmes écrivent dans leur coin, œuvrent à leur art et continuent avec patience et pugnacité à nous éclairer dans ces temps de ténèbres. Le dernier que j’ai dévoré, Le verger de marbre d’Alex Taylor, déjoue à lui tout seul tous les pronostics pessimistes. Mille fois, on nous a vendu la mort du genre, trop politique, trop engagé, trop ceci, pas assez cela, mille fois la littérature noire resurgit, longue ou courte, là où on ne l’attend pas. Voilà qui est proprement stupéfiant, et réjouissant en définitive.
C’est la première fois qu’il y a autant de temps entre deux romans. Mais pourquoi nous faire languir siiii longtemps ? Comment est né ce livre ? Quel en a été son cheminement ?
En réalité, c’est à peu près le laps de temps qui sépare la publication de trois de mes romans, Les visages écrasés (avril 2011), Dans le ventre des mères (octobre 2012) et L’homme qui a vu l’homme (janvier 2014). La vraie différence avec ce roman, c’est le processus d’écriture. Pour des raisons personnelles, j’ai traversé l’an passé une période difficile et peu propice à l’écriture. Le travail sur Au fer rouge m’a également pompé beaucoup d’énergie, techniquement. J’ai beaucoup hésité à me relancer dans l’écriture. J’ai énormément lu. Je sentais que j’étais à une sorte de carrefour, je me posais des questions sur ce que j’avais envie d’écrire, comment je voulais l’écrire, comment je construisais mes personnages, bref, ma petite cuisine intérieure. Il y avait ce roman de Sophie Divry, La condition pavillonnaire, qui m’a profondément marqué par sa langue et sa justesse d’analyse. Le contexte français et international pesant que l’on sait, les attentats, l’abattement, les luttes qui ressurgissent d’on ne sait où, miraculeuses. Ma petite place microscopique dans tout ça. Les romanciers sont des éponges, pour le meilleur et pour le pire. Et puis il y a eu cette demande du festival polar de Lamballe, à qui je devais rendre une nouvelle sur le thème « Dur(e) à cuire » pour l’été 2015. Une vingtaine de pages, longue, très longue à accoucher. Le personnage d’Emilie s’est imposée très vite, sorte de combattante vengeresse en colère contre le monde, mais l’écriture à proprement parler m’a pris plusieurs mois. Essentiellement parce qu’après mes deux romans basques je voulais passer à autre chose, d’abord pour moi, pour ne pas me lasser, parce que je change aussi, j’imagine. Je suis vraiment fier du résultat.
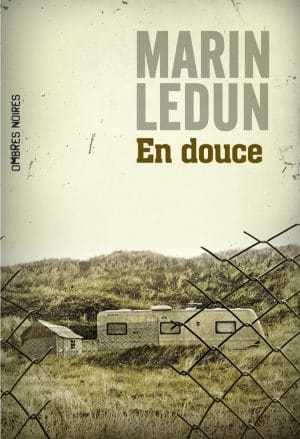
J’ai aussitôt attaqué l’écriture du roman En douce, en transformant évidemment la structure de la nouvelle qui ne convenait pas à un format plus long mais en conservant ce formidable personnage d’Emilie auquel je m’étais vraiment attaché. J’ai commencé, et je me suis arrêté. Nouveau blocage. La nouvelle intitulée Quelques pas de danse a finalement été publiée en novembre 2015… le jour d’une nouvelle vague d’attentats à Paris qui a d’ailleurs conduit à l’annulation du festival, sur décision de la préfecture – un non-sens ! Le tournage de l’adaptation des Visages écrasés avec Isabelle Adjani, Corinne Masiero, Ola Rapace, Sébastien Chassagne a débuté à Roubaix, mi-novembre, dans ce contexte dur et compliqué. En visionnant certains rushs de scènes tournées en mon absence, il y a eu comme un déclic, en particulier sur une scène bouleversante et criante de vérité où Isabelle Adjani (la médecin du travail, Carole Matthieu et Sarah Suco (la fille de Carole Matthieu dans le film) s’affrontent. Le tournage terminé, je me suis remis au travail et l’histoire d’En douce s’est mise en place d’elle-même. Cette fin que je peinais à trouver s’est imposée. Toutes ces phrases, ces sensations, ces scènes que j’amassais dans un coin depuis des mois se mettaient enfin en place. J’ai écrit les deux derniers tiers du roman en dix fois moins de temps qu’il ne m’en a fallu pour le début. Le titre, lui, m’a été soufflé voici cinq ou six ans par un cousin qui m’est cher, au cours d’une soirée stimulante à discuter lendemains qui chantent. Il faut croire qu’il attendait son heure.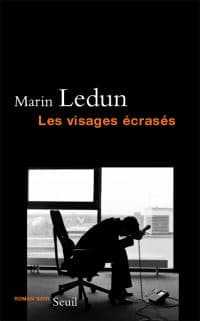
En douce fait l’objet d’un beau soutien de Flammarion dans la rentrée littéraire, que ressentez-vous ? Et après avoir publié chez différents éditeurs, avez-vous trouvé « votre maison ? »
Très beau, en effet. Une rentrée littéraire Flammarion pour un auteur de « noir », quel bel engagement ! Des gens formidables me soutiennent et m’aident à progresser, depuis le début ou presque de l’aventure Ombres Noires. Il y a d’abord eu Stéfanie Delestré, alors directrice de la collection « Le Poulpe » chez Baleine, maintenant éditrice chez Albin Michel, qui a soutenu Les visages écrasés puis qui m’a relancé pour Dans le ventre des mères. Nelly 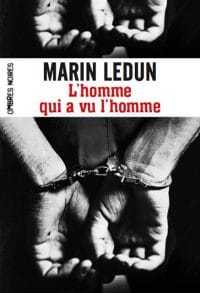 Bernard, ensuite, qui a construit Ombres Noires pour Flammarion, la collection dans laquelle je publie depuis quatre romans, déjà présente depuis Les visages écrasés et super éditrice sur Dans le ventre des mères et L’homme qui a vu l’homme. Remplacée en 2013 par Caroline Lamoulie qui s’occupe de moi depuis maintenant trois ans et qui soutient vraiment mon travail. Il y a bien sûr la formidable Olivia Castillon, qui me suit et me défend maintenant depuis quatre romans, et Hervé Delouche, qui officie en tant que correcteur sur mes romans et mes nouvelles depuis Les Visages écrasés, et à qui, par sa précision et son professionnalisme, mes romans doivent considérablement. Tout cela forme une espèce d’alchimie qui fonctionne à merveille aujourd’hui. Un éditeur qui vous fait confiance, des gens qui aiment votre travail pour ce qu’il est, qui sont là dans les bons comme dans les mauvais moments, que demander de plus ?
Bernard, ensuite, qui a construit Ombres Noires pour Flammarion, la collection dans laquelle je publie depuis quatre romans, déjà présente depuis Les visages écrasés et super éditrice sur Dans le ventre des mères et L’homme qui a vu l’homme. Remplacée en 2013 par Caroline Lamoulie qui s’occupe de moi depuis maintenant trois ans et qui soutient vraiment mon travail. Il y a bien sûr la formidable Olivia Castillon, qui me suit et me défend maintenant depuis quatre romans, et Hervé Delouche, qui officie en tant que correcteur sur mes romans et mes nouvelles depuis Les Visages écrasés, et à qui, par sa précision et son professionnalisme, mes romans doivent considérablement. Tout cela forme une espèce d’alchimie qui fonctionne à merveille aujourd’hui. Un éditeur qui vous fait confiance, des gens qui aiment votre travail pour ce qu’il est, qui sont là dans les bons comme dans les mauvais moments, que demander de plus ?
Les citations d’introduction vont de Harry Crews à Sophie Divry… Bel éclectisme…
Quel beau mariage, pourtant ! Leurs romans m’ont nourri pendant l’écriture d’En douce, par leur langue, leur manière, tantôt crue et sèche, tantôt poétique, de raconter le monde. Lisez La condition pavillonnaire de S. Divry et l’intégrale d’Harry Crews à commencer par Car et, mon préféré, Nu dans le jardin d’Eden, récemment traduit et publié chez Sonatine. Et puis, tiens, lisez aussi Erskine Caldwell : Le petit arpent du bon Dieu, La route au tabac, Le doigt de Dieu… Sans eux, En douce n’existerait pas.
J’ai pu lire récemment de vous : « J’ai la conviction que le roman à caractère social est un outil nécessaire de déconstruction du monde dans lequel nous vivons »… Vous nous en dites plus ?
Qu’est-ce que le noir, au fond ? Une littérature « en phase avec le réel, la vie », une littérature « d’urgence », aussi efficace que « des singles de deux minutes balancés par des guitares saturées. » nous dit l’un des spécialistes français de la nouvelle noire, Marc Villard (interview donnée à Libération, le 1er avril 2015). Quel est donc ce réel, cette vie dont il nous parle ? « Il raconte que la seule valeur universelle aujourd’hui, au-delà des discours électoraux, est celle de l’argent » nous dit l’écrivain Dominique Manotti (« Hammett et Ellroy auraient-ils voté Mélenchon ? », Le Nouvel Observateur, 18 avril 2012). « Il raconte comment un petit groupe de dirigeants socialement soudés rackette légalement et sans risques les grandes entreprises, à travers primes, salaires, stock-options et parachutes dorés comment le mélange de l’argent « propre » et de l’argent noir s’opère sous la garantie des États dans les paradis fiscaux. Il raconte les trafics de drogues et de marchandises en tout genre, les blocus, les contrebandes, les formes d’exploitation sauvage et meurtrière. La montée des « agents » et intermédiaires divers, comme acteurs indispensables de la culture de la corruption, et le recours aux gros bras et aux tueurs en cas de besoin. »
Lire et écrire du noir, vaste et généreux programme de résistance à l’air du temps !
La littérature noire, comme sa sœur policière place le crime au centre de l’histoire. A un détail près : pour elle, le crime n’est pas marginal, il n’est pas une anomalie de nos sociétés, mais au contraire leur fondement même, leur principe constitutif. Elle nous parle donc d’un monde profondément en crise dans lequel toutes formes de résistances individuelles et collectives sont des exceptions, un monde où des femmes et des hommes se débattent pour créer du sens, établir une justice, luttent contre la normalité, le plus souvent en vain, car comme le précise là encore D. Manotti, « Comment combattre ces crimes sans briser la machine ? » Paradoxalement, c’est certainement ce qui fait le succès de cette littérature dans les périodes de crises économiques et politiques majeures : face à la montée de l’insignifiance, nous avons soif de comprendre, de décortiquer, d’analyser, de prendre du recul, de sentir que nous ne sommes pas seuls, atomisés face à la machine de guerre néolibérale, de voir que d’autres résistent, un peu partout.
Là est la force de cette littérature qui, comme le roman social dans les deux siècles qui l’ont précédé, et dans la tragédie antique bien avant encore, interpelle l’individu, l’embarque sur dix, six cents ou mille pages, le happe, le provoque, le force à se remettre en question, lui tord le ventre, non parce qu’elle lui fait peur, mais par ce qu’elle lui révèle de lui-même et des mécanismes souterrains et obscènes de la société dans laquelle il vit, sans jamais le lâcher, sans concession aucune, sans les œillères du déni, de la satisfaction consumériste, du frisson bon marché et de la morale, comme si sa propre existence en dépendait. En définitive, pour paraphraser Sartre (Qu’est-ce que la littérature ?, Gallimard, 1948), la littérature noire, « de quelque côté qu’on la prenne, est un acte de confiance dans la liberté des hommes » ou, comme l’écrivait Thucydide, « se reposer ou être libre, il faut choisir. » Lire et écrire du noir, vaste et généreux programme de résistance à l’air du temps !
En douce est un livre sec, brut, concentré, qui contraste avec vos deux livres précédents – une forme nécessaire ?
D’abord, c’est un travail que j’ai surtout commencé avec Au fer rouge. Le 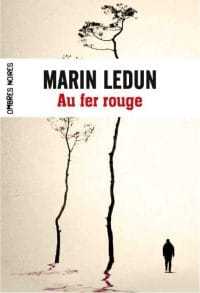 roman est long et dense, cinq ou six personnages, mais un an et demi d’écriture et de travail, mot à mot, pour l’épurer au maximum. J’ai coutume de dire, en atelier d’écriture, que deux adjectifs dans une phrase, c’est probablement deux adjectifs de trop. J’exagère, évidemment, mais l’idée est là quand je planche sur une phrase : comment la rendre encore plus synthétique, donc plus efficace et sous tension. Ensuite, depuis trois ans, je me suis mis à l’écriture de nouvelles, ce dont je ne me sentais absolument pas capable auparavant. Bizarrement, j’en avais peur. La nouvelle, pour moi, c’est l’école de l’humilité. C’est l’ascèse. Un truc inaccessible a priori, réservé à ceux qui maîtrisent leur affaire après des années et des années de pratique. Un petit peu comme l’héroïne de Kil Bill de Tarantino qui s’abîme les phalanges sur une planche de bois pendant des années avant de parvenir enfin à la briser d’un coup sec. J’ai donc travaillé, longuement, sur mes nouvelles, des Petits polars du Monde à No more Natalie pour la collection « Polaroïd » de Marc Villard, un maître du genre, chez In8 éditions. Ici, il y a d’abord eu Quelques pas de danse et seulement après En douce, le roman. Le décor et le personnage principal étaient campés, je les connaissais parfaitement, j’avais suffisamment de recul pour ne conserver d’eux que le strict nécessaire pour raconter mon histoire. J’imagine aussi qu’avec le temps, j’évite les digressions. J’essaie, en tout cas. Et j’aspire à cette écriture-là. Donc, oui, une forme nécessaire, un style sec et brutal, comme le sont Émilie et son rapport au monde.
roman est long et dense, cinq ou six personnages, mais un an et demi d’écriture et de travail, mot à mot, pour l’épurer au maximum. J’ai coutume de dire, en atelier d’écriture, que deux adjectifs dans une phrase, c’est probablement deux adjectifs de trop. J’exagère, évidemment, mais l’idée est là quand je planche sur une phrase : comment la rendre encore plus synthétique, donc plus efficace et sous tension. Ensuite, depuis trois ans, je me suis mis à l’écriture de nouvelles, ce dont je ne me sentais absolument pas capable auparavant. Bizarrement, j’en avais peur. La nouvelle, pour moi, c’est l’école de l’humilité. C’est l’ascèse. Un truc inaccessible a priori, réservé à ceux qui maîtrisent leur affaire après des années et des années de pratique. Un petit peu comme l’héroïne de Kil Bill de Tarantino qui s’abîme les phalanges sur une planche de bois pendant des années avant de parvenir enfin à la briser d’un coup sec. J’ai donc travaillé, longuement, sur mes nouvelles, des Petits polars du Monde à No more Natalie pour la collection « Polaroïd » de Marc Villard, un maître du genre, chez In8 éditions. Ici, il y a d’abord eu Quelques pas de danse et seulement après En douce, le roman. Le décor et le personnage principal étaient campés, je les connaissais parfaitement, j’avais suffisamment de recul pour ne conserver d’eux que le strict nécessaire pour raconter mon histoire. J’imagine aussi qu’avec le temps, j’évite les digressions. J’essaie, en tout cas. Et j’aspire à cette écriture-là. Donc, oui, une forme nécessaire, un style sec et brutal, comme le sont Émilie et son rapport au monde.
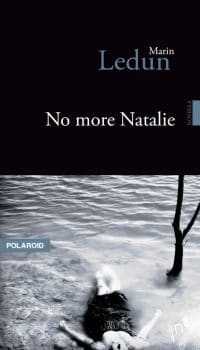
En parlant de forme, « Comme au cinéma : arrêt sur image, fondu enchaîné et ralenti »… Je trouve que votre écriture est arrivée à un énorme rendu de cinéma : en peu de mots, le décor est posé, le lecteur ressent l’ambiance… ça force le respect… Alors, comment avez-vous travaillé tout ça ?
C’est un peu comme Simon Diez, dans En douce, au moment de couper son chêne. Il faut d’abord inspecter l’arbre, penser sa chute, puis il faut vérifier son matériel, aiguiser ses outils avec soin, puis attaquer l’arbre à proprement parler, préparer l’encoche, tailler les éventuelles résurgences racinaires, au besoin passer la lame de la tronçonneuse au cœur de l’arbre, et enfin, seulement enfin, couper. Reste à débiter selon si l’on veut des planches, des piquets ou du bois de chauffage, élaguer, fendre puis empiler pour le séchage, nettoyer le matériel et le ranger pour une prochaine utilisation. C’est long, c’est lent, mais chacune de ces étapes est nécessaire si l’on veut pouvoir être fier du travail bien fait. Cette scène est centrale dans En douce parce qu’elle résume en même temps ce que sont mes personnages et ma manière de travailler. Prendre son temps, écrire, réécrire, une fois, dix fois, vingt fois la même scène, le même dialogue, jusqu’à ce qu’elle/il sonne.
Comment avez-vous fait pour donner corps à cette femme brisée ?
Je n’en sais rien. C’est la première fois que j’écris un roman sans documentation, sans thématique de départ, sans effet de réel. Émilie est une fiction. Émilie est ma plus pure fiction. C’est également un personnage qui n’est que par ce qu’elle fait ou par les mots qui sortent de sa bouche. Voilà comment elle est définie : par ses actes. Aujourd’hui, pour moi, c’est la bonne manière de travailler.
Et ensuite pour ce portait tout en finesse : son handicap, sa prothèse, le regard que lui portent les autres…
Les actes d’Émilie l’incarnent. Elle prend corps à travers eux, alors que j’ai pris soin de très peu la décrire, physiquement, dans le roman. Son trait physique principal étant ce qui lui fait défaut : sa jambe. Bizarrement, la manière dont je l’ai travaillée me vient de la lecture d’un recueil de nouvelles de Donald Ray 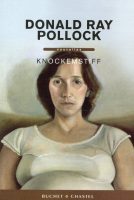 Pollock qui n’ont, a priori, rien à voir, et qui m’ont bouleversé. J’ai découvert Knockemstiff sur les conseils de Jean-Bernard Pouy, après avoir lu son premier roman, Le diable, tout le temps. Son économie de moyens, sa façon d’incarner, de faire vivre ses personnages en quelques mots, quelques gestes, parfois sur la base d’un seul détail vestimentaire ou un bout de dialogue, ses premières phrases toujours acérées comme dans La vie en vrai : « Un soir d’août au Torch Drive-in quand j’avais sept ans mon père m’a montré comme faire mal à quelqu’un. » ; dans On achève bien les cheveux : « Quand les gens en ville parlent de consanguins, en réalité ce qu’ils veulent dire c’est qu’il arrive de se sentir seul. » ; ou encore dans Dynamite Hole : « Je descendais juste des Mitchell Flats avec trois pointes de flèche dans ma poche et un serpent copperhead mort qui me pendait autour du cou comme un châle de vieille bonne femme, quand j’ai surpris un gars nommé Truman Mackey en train de baiser sa petite sœur dans Dynamite Hole. » Une ambiance, un ton, un trait de caractère, une situation, posés en une seule phrase.
Pollock qui n’ont, a priori, rien à voir, et qui m’ont bouleversé. J’ai découvert Knockemstiff sur les conseils de Jean-Bernard Pouy, après avoir lu son premier roman, Le diable, tout le temps. Son économie de moyens, sa façon d’incarner, de faire vivre ses personnages en quelques mots, quelques gestes, parfois sur la base d’un seul détail vestimentaire ou un bout de dialogue, ses premières phrases toujours acérées comme dans La vie en vrai : « Un soir d’août au Torch Drive-in quand j’avais sept ans mon père m’a montré comme faire mal à quelqu’un. » ; dans On achève bien les cheveux : « Quand les gens en ville parlent de consanguins, en réalité ce qu’ils veulent dire c’est qu’il arrive de se sentir seul. » ; ou encore dans Dynamite Hole : « Je descendais juste des Mitchell Flats avec trois pointes de flèche dans ma poche et un serpent copperhead mort qui me pendait autour du cou comme un châle de vieille bonne femme, quand j’ai surpris un gars nommé Truman Mackey en train de baiser sa petite sœur dans Dynamite Hole. » Une ambiance, un ton, un trait de caractère, une situation, posés en une seule phrase.
En parlant de prothèse, avez-vous lu le très beau Ikebukuro West Gate Park ? qui traite d’une chanteuse pop japonaise unijambiste ?
Non, mais je note la référence qui m’évoque le travail photographique du romancier Romain Slocombe. La jambe absente d’Émilie est une métaphore de ce que la société des hommes lui a pris avec les rêves de ses parents puis en la déclassant. A propos de Que ma joie demeure, publié en 1936, et de son rapport particulier à la religion, Jean Giono dit qu’il ne faut renoncer à rien, qu’il « est facile d’acquérir une joie intérieure en se privant de son corps. Je crois plus honnête de rechercher une joie totale, en tenant compte de ce corps, puisque nous l’avons. » Dans ce sens, Émilie est une femme qui refuse de renoncer, de se priver de ce corps qui, même amputé, est la source de sa joie, de son plaisir et de sa force.
Une femme admirable, digne, toujours prête à prendre soin des autres, dont le corps souffre de cette vie de forçat mais qui semble comprendre, de façon aigüe, presque intuitive, le monde dans lequel nous vivons plus que je n’ai su le faire dans chacun de mes romans précédents.
Émilie à un moment dit « Suis l’odeur du mâle »… cela change du célèbre « cherchez la femme… »
Rien ne vous échappe… Émilie évolue dans un milieu machiste et éprouvant, dur physiquement, celui des ouvriers agricoles et des forestiers où les hommes chassent en meute, sillonnent les forêts en grosses voitures tout-terrain, manient des tronçonneuses de cinq ou six kilos à bout de bras, déplacent des troncs de plusieurs centaines de kilos, grimpent aux cimes des pins pour les élaguer, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. Émilie doit faire sa place dans ce monde-là. Elle doit le faire dans la douleur parce qu’elle est en résistance, parce qu’elle ne veut pas subir le monde mais l’affronter. Elle veut être au-dessus des hommes. Elle entend être meilleure qu’eux. Elle veut que les hommes paient pour ce qu’elle a subi, pour son déclassement, pour ses rêves brisés, mais plus que tout, elle entend gagner sa liberté, en s’émancipant du schéma familial sur lequel sa vie était calquée, et en mettant tout en œuvre pour comprendre ce qui lui arrive et le monde dans lequel elle vit.
J’ai pour habitude de puiser la matière de mes romans dans des faits politiques ou sociaux. Je passe ensuite plusieurs mois à me documenter, puis je construis mes personnages et mon histoire avant de m’atteler à l’écriture. Ici, pour la première fois, j’ai fait l’exact chemin inverse. En douce est bâti autour de la vie d’une ouvrière jetée à l’adolescence sur le marché de l’emploi. Une force de la nature. Une femme levée à trois heures du matin pour se rendre au travail, six jours sur sept. Une femme admirable, digne, toujours prête à prendre soin des autres, dont le corps souffre de cette vie de forçat mais qui semble comprendre, de façon aigüe, presque intuitive, le monde dans lequel nous vivons plus que je n’ai su le faire dans chacun de mes romans précédents. Voilà comment est née Émilie, l’héroïne de ce roman. Voilà ce qu’elle est. Un personnage universel capable d’exprimer le doute, la colère et l’espoir. Une femme bouillonnante qui relève la tête et cherche à comprendre ce qui n’a pas fonctionné dans sa vie et dans la société dans laquelle elle a grandi. Émilie est un personnage formidablement positif. Elle vibre d’une conscience exacerbée de la vie, puissante, violente, presque incontrôlable.
Dans ce livre, c’est surtout l’odeur du chenil qui surnage, alors, à l’image des écrivains américains qui donnent de leur personne pour écrire un roman, avez-vous travaillé dans un chenil pour en rendre si bien l’ambiance ?
Disons que j’ai travaillé autour d’un chenil, que j’en connais le fonctionnement, que j’ai mené ma petite enquête et que je connais bien le milieu des ouvriers agricoles qui gravite autour de ce chenil. Le reste n’est que pure fiction…
Le livre se passe à Begaarts, qui n’existent pas, mais ça sent fortement Les Landes. Besoin de souffler après des livres très ancrés dans des lieux précis ?
Votre question est importante pour moi. C’est moins une affaire de lieux que de style. L’histoire se déroule vraisemblablement dans les Landes, mais elle pourrait tout aussi bien se passer sur les côtes normandes, en Ardèche ou dans le Gers ou même encore dans une zone urbaine. L’essentiel ici, c’est Émilie, mais aussi sa jambe absente, sa souffrance et sa volonté d’émancipation, ses actes et son environnement immédiat. Le décor ne vaut qu’à travers Émilie. Le chenil est une métaphore du monde de chiens dans lequel elle évolue, une sorte de reproduction en fractale de l’hôpital où elle travaillait avant en tant qu’infirmière. Les chiens ont remplacé les hommes pour exacerber son rapport conflictuel avec la société des hommes.
« On est pas des médiocres. C’est l’image qu’ils nous renvoient de nous-mêmes, mais crois-moi, ce n’est pas le cas. On est le peuple et le peuple n’est jamais médiocre. » Un commentaire sur ce que dit Émilie ?
C’est quelque chose de très violent que nous ressentons, toutes et tous, j’imagine, cet espèce de mépris de classe que nous renvoient certains dirigeants, certains hommes ou femmes politiques, quelqu’un comme le ministre de l’économie Emmanuel Macron par exemple, avec sa fameuse tirade « Vous n’allez pas me faire peur avec votre tee-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c’est de travailler » prononcée en mai dernier à l’encontre d’un gréviste, lors d’un déplacement à Lunel, dans l’Hérault. Mépris de classe que nous renvoie également tout un magma de procédures dans le travail ou pour les personnes au chômage, telles que les « entretiens de progrès » ou les « bilans de compétences » qui sont autant de techniques d’humiliation quotidiennes. Je pense aussi à cette scène magnifique et terriblement humiliante à Pôle Emploi où Thierry (Vincent Lindon), privé de travail dans La loi du marché de Stéphane Brizé échange avec son « conseiller » à propos d’une formation qu’il a faite suite à un bilan de compétence et qui s’est avérée totalement inutile dans sa recherche d’emploi. C’est aussi quelque chose de frappant, actuellement, dans cette résistance qui s’est mise en marche contre la loi « Travail » ultra-libérale où précisément le peuple refuse d’accepter ce mépris de classe qui leur dit « Faites-nous confiance, c’est bon pour vous, puisqu’on vous le dit ! » et continue d’être majoritairement défavorable à la loi El Khomri, la très mal nommée « loi travail », et favorable à son retrait, en dépit d’une propagande gouvernementale inouïe centrée sur les casseurs et la CGT. Voilà, je crois, ce que les gens clament haut et fort « Nous ne sommes pas des médiocres ! » même s’il est difficile d’être entendu dans un pays où certains principes démocratiques de base sont quotidiennement bafoués.
« La société ? Ça signifie quoi, la société ? Qu’est-ce que c’est ? » Émilie a son idée, et vous ?
Plutôt que de me risquer à répondre à cette question épineuse et infiniment complexe, je vous renvoie vers La société des individus et La civilisation des mœurs de Norbert Elias.
J’adore votre idée des « lignes » – nous n’en dirons pas plus, les lecteurs verront (p208/209) d’où vous est venue cette représentation ?
Assez simplement : je fonctionne comme cela. Par lignes qui se croisent. A l’école primaire, l’une de mes enseignantes nous conseillait de ranger notre cerveau en tiroirs dans lesquels glisser idées et leçons. J’étais d’un naturel maniaque, j’ai donc essayé. Je n’y suis jamais parvenu. Mon crâne est rempli de cordes, de fils, de lignes, de plis, non pas abstraites mais de vraies représentations mentales imaginaires de plis, de lignes, de fils et de cordes, la plupart du temps chronologiques, à l’image de ces frises en forme de flèche que l’on étudiait en cours d’histoire, sauf que dans mon cas, elles se tordent, s’étirent, coupent d’autres frises, liées à d’autres histoires, d’autres personnes…
Je viens de là, d’une Ardèche rurale qui a imprégné mon imaginaire et façonné ma représentation du monde.
Dans ce livre on y croise des gens qui abattent encore des arbres à la hache… J’ai ouï-dire que vous aussi… Alors si certains font l’éloge du carburateur, feriez-vous l’éloge des travaux de la terre ?
Je ne fais l’éloge de rien du tout. J’ai fait des choix de vie, plutôt proches de la terre, effectivement, et si possible le plus loin possible de la société de consommation que je vis comme une formidable perte de temps, une illusion, un mépris et une éloge de l’insignifiance. Après, c’est une affaire de goût et de reproduction sociale : je viens de là, d’une Ardèche rurale qui a imprégné mon imaginaire et façonné ma représentation du monde. Adolescent, je travaillais dans les exploitations agricoles de mes oncles, essentiellement taille de fruitiers et récolte, je me faisais de l’argent de poche en remontant des murs de pierres sèches effondrés par les pluies, je passais mes vacances à courir les chemins et les abords des rivières du sud du département, puis, après un break urbain de quinze ans, me voilà dans ce magnifique coin de France que sont les Landes, à quelques kilomètres de l’océan, au milieu de nulle part, à apprendre et réapprendre tous ces gestes quotidiens de taille, d’élagage, de coupe, d’entretien… En douce, comme dans un autre de mes romans, Luz – qui va connaître une nouvelle vie, à la rentrée, en poche chez J’ai Lu – c’est aussi une façon d’écrire sur ce rapport à la terre, à la nature, à la petite agriculture rurale, à la lenteur merveilleuse des gestes quotidiens, à l’outil bien aiguisé, à la pierre bien placée, à cette pêche, si bonne et gorgée de sucre qu’un type a fait pousser avec amour du travail bien fait, à toutes ces choses auxquelles je suis infiniment plus sensible du fait de mon éducation et de mon enfance.
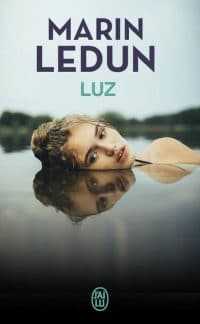
Des articles courraient sur l’adaptation en film de Les visages écrasés, où en êtes-vous ?
Comme je vous le disais, le tournage a eu lieu à Roubaix entre novembre et décembre 2015. Forcément, une adaptation sur ce roman-là, sur la souffrance au travail, ce fut un moment particulier pour moi. Voir ce livre en séquences, avec des personnages de chair et d’os, porté par Isabelle Adjani métamorphosée en Carole Matthieu, mon personnage, immense actrice au service d’un rôle mais aussi d’une idée et d’un sujet, époustouflante, vraiment – j’ai encore en tête certaines scènes du tournage où, bon sang ! elle incarne Carole Matthieu mieux que je ne l’ai écrit ! Et Corinne Masiero dans le rôle de la DRH ! Et Sarah Suco ! Et Lyès Salem dans le rôle d’Alain, le représentant syndical ! Et Alexandre Carrière, troublant de ressemblance dans le rôle de Vincent Fournier, l’homme par qui tout arrive ! Des actrices et des acteurs immenses, conscients du sujet du roman, impliqués. Un scénario avec de  nécessaires et salutaires réajustements qui tiennent compte des difficultés d’adaptabilité du roman. Le réalisateur, Louis-Julien Petit, m’a proposé un (tout) petit rôle / figuration de délégué du personnel que j’ai finalement accepté, ce qui m’a permis de me mêler aux joyeuses troupes de figurants, d’acteurs et de tous les travailleurs, techniciens, script, etc. qui permettent au film d’exister. Depuis le film est monté et il existe, maintenant, n’attendant plus qu’une diffusion sur Arte, probablement entre novembre 2016 et janvier 2017. J’ai eu la chance de le voir et je suis convaincu ! J’imagine qu’on aura l’occasion d’en reparler.
nécessaires et salutaires réajustements qui tiennent compte des difficultés d’adaptabilité du roman. Le réalisateur, Louis-Julien Petit, m’a proposé un (tout) petit rôle / figuration de délégué du personnel que j’ai finalement accepté, ce qui m’a permis de me mêler aux joyeuses troupes de figurants, d’acteurs et de tous les travailleurs, techniciens, script, etc. qui permettent au film d’exister. Depuis le film est monté et il existe, maintenant, n’attendant plus qu’une diffusion sur Arte, probablement entre novembre 2016 et janvier 2017. J’ai eu la chance de le voir et je suis convaincu ! J’imagine qu’on aura l’occasion d’en reparler.
Lorsqu’on voit votre agenda, vous êtes en perpétuel déplacement… Quand trouvez-vous le temps d’écrire ?
Je me souviens d’une discussion avec le romancier Marcus Malte, à mes débuts. Je venais de découvrir les fantastiques Garden of love et La part des chiens. Je le voyais tout le temps sur les routes, essaimant de festivals en rencontres scolaires. Effaré, je lui demandai quand il trouvait le temps d’écrire et il me répondit, mi-amusé, mi-grave : « Je ne le trouve pas. » Jean-Christophe Brochier qui a publié Les visages écrasés – qu’il en soit à jamais remercié ! – parlait de mon agenda comme d’un « never ending tour » On en est là. Il est compliqué de rester seul dans son coin, même si j’ai une vie personnelle riche. Des amitiés itinérantes se tissent, solides. De belles choses naissent des rencontres auxquelles je participe tout au long de l’année. Des rencontres importantes. Pour moi, ces déplacements sont indissociables de l’activité d’écriture, même si avec des semaines de trois voire cinq jours hors de chez moi, il est parfois compliqué de me remettre sur mon ordinateur. Je n’écris que chez moi mais j’ai besoin des gens. Impossible, comme le font certains, d’écrire dans le train ou à l’hôtel. Je dois donc prendre mon mal en patience, griffonner le dos de mes billets de TGV de notes fébriles, d’idées, de bouts de dialogues, et finalement, j’y trouve mon compte dès qu’une période de plusieurs semaines dans des festivals se profile. Il ne suffit pas de se mettre devant un ordinateur pour que les mots et les histoires sortent. Tout cela demande de la maturation, tout cela prend du temps que mes déplacements, au même titre que mes différentes activités forestières et de travail du bois, m’offrent. Le temps est un luxe que je me suis offert.
Dans En douce vous parlez de Bullhead, quel est votre rapport au cinéma ? Vous qui êtes toujours en déplacement (l’avantage de l’hôtel c’est qu’il y a souvent une télé et le câble…) ?
Pas de télévision, même à l’hôtel, ou le moins possible. Les romans et la musique sont une part importante de ma vie, mais pas le cinéma. Des amis me conseillent des films, mais en fin de compte, à part des obsessions pour Kim Ki-Duk, Wong Kar-Wai, Kusturica, Sergio Leone ou Bad boy Bubby de Rolf De Heer, je vois très peu de films et encore moins de nouveautés. C’est un regret, mais je n’ai pas assez de temps pour cela. Pour être franc, j’ai dû voir en tout et pour tout trois ou quatre séries, géniales d’ailleurs, la saison 1 de True Detective, le parfait The Wire ou le génial Breaking Bad. Le rythme des séries me convient assez bien. Lent. Sur la durée. Comme j’ai un rapport assez obsessionnel à ce qui me plaît et que je regarde ces films et ces séries des années après leur sortie. Dans ce dernier cas, l’intégrale est alors disponible et je peux regarder, une fois la journée terminée, trois à quatre épisodes d’affilée, voire à re-visionner ceux qui m’ont plu, comme j’ai déjà vu Le bon, la brute et le truand ou Papa est en voyage d’affaires de Kusturica des dizaines de fois. Comme j’en regarde peu et lentement, je connais les dialogues, le découpage, les personnages, les bandes-son par cœur. J’ai ce même rapport obsessionnel avec mes romans, depuis quelques années. Il me faut du temps pour digérer un roman, comme pour digérer un film. J’analyse, je décortique. C’est ma façon de travailler.
Entre deux livres, on peut voir des pièces radiophoniques, comment abordez-vous ce travail ?
Les pièces radiophoniques que j’écris pour France Culture ou, l’an passé, pour France Inter, sont un prolongement, sous forme dialoguée, de mon travail sur le monde de l’entreprise. En général, je m’y attelle entre deux romans. Ce qui est formidable avec les pièces radio, c’est qu’elles constituent un exercice périlleux de scénarisation et de travail sur les dialogues. La moindre faute de narration et la pièce devient aussitôt bancale et cela se voit ! Ce travail rigoureux « paie » ensuite dans les phases d’écriture d’un roman. Je viens juste d’en terminer une pour France Culture qui s’intitule Le monde dans lequel nous vivons, l’histoire d’amour tragique d’un mécanicien lessivé par les cadences infernales de la société de contrôle technique. Nous entrons maintenant dans la phase de recherche d’un réalisateur que le projet séduira. Je profite de votre question pour remercier Caryl Férey, puis Sophie Loubière plus récemment, qui m’ont mis le pied à l’étrier.
Et, car lorsqu’un livre sort, en général l’auteur travaille déjà sur le prochain… un mot sur le prochain ? Car je me disais que si vous manquiez d’inspiration vous pourriez toujours vous spécialiser en Nature writing, comme en témoigne votre description de l’étang d’Amoréna (p99).
Point de Nature writing, dans l’immédiat, ni de panne d’inspiration, mais je suis encore dans En douce et c’est suffisant, pour l’instant.
Des choses à rajouter ?
Merci à vous.
Pour aller plus loin
Le site de Marin Ledun
Les pièces radiophoniques de Marin Ledun sur France Culture
